
| COMPORTEMENTS
ABSTRAITS ET CONTIGUITE SEXUELLE Texte de référence pour toutes les pages qui abordent la linguistique structurale. Mise à jour d'un article paru dans L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 63, 4, 1987, PP. 553 à 566. |
| 1 - Première partie | 2 - Deuxième partie | 3 - Troisième partie |
| LA GESTION DE LA RESSEMBLANCE DANS LA CONTIGUÏTE | LA DECOUVERTE DE CLIVAGE ONTOLOGIQUE : LES ETAPES | TOUS LES PLANS DE LA REALITE |
| 11 - Dans la vie de tous les jours... | 21 - Roman
Jakobson | 311 - Les
religions 312 - La patrie 313 - L'échange sexuel |
| 12 - ...Et d'autres problèmes humains | 22 - Lucien
Sebag | 32 - L'autonomie des facteurs d'antagonisme |
| 13 - Les sources, Morier | ||
| 14 - L'autonomie des comportements abstraits |
1 - Première partie UN PROBLEME CAPITAL: LA GESTION DE LA RESSEMBLANCE DANS LA CONTIGUÏTE Dans une série de texte consacré aux hallucinations, à la psychopathologie, à la pudeur nous avons étayé notre argumentation sur l'opposition irréductible des deux procès de dévoilement du réel : la similarité et la contiguïté. Nous avons attribué à Roman Jakobson et Lucien Sebag la mise à jour de cette bipartition et de l'exclusion mutuelle de ces deux types de relations. (Voir pages recherche l'analogique et le contigu). L'un des effets les plus importants de ce clivage se résume ainsi: Sur un même espace cohérent, qu'il soit spatial, temporel ou psychologique, le contact du même au même est générateur de crise si les termes en présence y établissent par ailleurs un rapport de contiguïté et font partie du même ensemble. 11 - Dans la vie de tous les jours... Un premier exemple peut paraître trivial: imaginons deux dames invitées à une même soirée et constatant qu'elles portent la même toilette; nul n'ignore le vif désagrément qu'elles ressentent. Autre cas qui n'est différent qu'en apparence: imaginons qu'un mari veuille apprendre à conduire à son épouse, nul n'ignore que cette tentative risque d'être tumultueuse. Mari et femme sont unis par des liens extralinguistiques de contiguïté qui fondent le couple. L'apprentissage de la conduite de l'un par l'autre vise à créer, entre eux, une similarité. Il saute aux yeux que celui qui apprend doit adopter, par rapport à l'autre, un comportement imitatif. Mieux vaut avoir recours au tiers médian : le moniteur d'auto-école. Pourquoi le situation sera-t-elle plus paisible? Parce que contiguïté et similarité ne convergeront pas sur la même personne. On note un dédoublement comme l'indique le schéma ci-après: 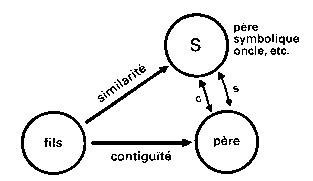 Nous verrons ailleurs que sur cet exemple pratique se fonde toute transmission de connaissances (...). Le problème peut être repris entre père et fils, l'aventure est encore risquée car père et fils sont liés par des liens extra linguistiques de contiguïté au sein de l'institution familiale. L'acte imitatif du fils sur le père ne va pas de soi. Ne sommes-nous pas face à l'antagonisme oedipien: Comment devenir semblable au père sur le terrain du contigu? 12 - ...Et d'autres problèmes humains En changeant de registre nous constatons, sur le versant de la psychopathologie, que la notion psychanalytique de résistance reflète la même incompatibilité. Le transfert attendu se crée par transposition sur le thérapeute de liens psychoaffectifs plus ou moins archaïque. Quand la résistance survient-elle? Quand le thérapeute dit juste. Autrement dit : quand il y a similarité entre les paroles (du thérapeute) et la réalité psychique (du patient), entre le prédicat formulé et explicite du thérapeute et le prédicat implicite et informulé de l'analysant. Sur le même terrain, on ne peut omettre le tabou de l'inceste qui révèle ici sa nature linguistique : si la relation mère-enfant supporte un état fusionnel de contiguïté exemplaire, c'est une évidence que la langue maternelle s'apprend en imitant la mère. On perçoit les abandons imposés à l'enfant par l'exclusion contigu / similaire: - soit le refus de la parole et le maintien exclusif des rapports de contiguïté: nous sommes dans l'autisme (ou toutes les variétés d'altération du langage), - soit l'apprentissage du langage, mais la mère, qui en est la source, sera alors la seule personne avec qui la contiguïté corporelle sera définitivement abandonnée dans son expression pure et ultime: la sexualité (voir textes sur la pudeur). Certains concepts fondamentaux de la psychanalyse comme celui déjà cité de résistance, ceux de refoulement, de castration, de sur-moi, de déni mettent en jeu des forces hypothétiques qu'engendrent (et qui engendrent) des antagonismes internes. Ces forces, dans la vision économique de la thèse freudienne fonctionnent comme des êtres ou, si l'on veut, des substances antagonistes qui sont nécessairement de même nature et par là capables de se combattre ou de s'annuler. De là découle d'ailleurs une des difficultés de la psychanalyse car le retournement de sens, (investissement oppositionnel) n'est pas toujours clairement expliqué ni explicable à partir de la force qui émanerait de façon univoque des mêmes pulsions ou des mêmes instincts. Le mérite des travaux conjoints de Jakobson et de Sebag est de faire apparaître des facteurs d'antagonisme qui sont d'une autre nature que les sources énergétiques classiquement envisagées (pulsions, instincts, besoins biologiques...). Non seulement les facteurs révélés par le clivage ontologique sont d'une autre essence, mais leur pouvoir est quasiment absolu et déterminant ainsi qu'on le voit au seul exemple du tabou de l'inceste. Ceci ne retire rien à la dynamique des processus de l'inconscient Freudien mis à jour à partir de la seule clinique. Il demeure que de nombreux points aveugles de la théorie analytique paraissent devoir être éclairés, en même temps que cette théorie se trouve débarrassée d'un anthropomorphisme qui posait problème. 13 - Les sources. Morier: Les deux facultés maîtresses de l'esprit Les concepts de similarité et contiguïté ont été mis en avant par Aristote qui décrivait sur cette base le fonctionnement de la mémoire. La similarité a sa traduction rhétorique dans la métaphore qui est l'abstraction de caractère commun entre les termes en présence. A la contiguïté répond la métonymie qui rend compte de l'appartenance des termes à un même ensemble. Morier fait un pas de plus et isole les deux facultés maîtresses de l'esprit : la comparativité et la connectivité: - La comparativité gouverne la similarité et la métaphore, fonction ou état qui lui sont congruents. - La connectivité, gouverne la contiguïté et la métonymie. Le cheminement jusqu'à nous s'est fait par la linguistique (après la longue pause de la rhétorique). Suivant l'intuition de Kruzewski, Jakobson, par le détour des aphasies, établit ce qu'il appelle le double caractère du langage et pressent l'importance de cette bipolarisation pour le comportement humain en général. Roman Jakobson ne relève pas le caractère mutuellement exclusif des deux procès. Le mérite en revient à Lucien Sebag, à partir de l'étude d'un mythe, dans un travail réellement fondateur. Mais ce chercheur structuraliste, est préoccupé par la transition entre pensée mythique et pensée rationnelle. Il n'a pas bâti un corpus théorique sur le sujet qui nous intéresse. Pour cette raison, la présentation de son oeuvre devra inclure la relation de certains éléments du mythe acoma, objet de son étude. 14 - L'autonomie des comportements abstraits Pour caractériser les facteurs dont nous parlons, procès métonymique et procès métaphorique, nous retiendrons l'expression de Jakobson qui les énonce comme des comportements abstraits. Ainsi désigne-t-il les opérations fondamentales de l'esprit humain qui gouvernent les relations avec le réel, selon qu'elles obéissent à l'une ou l'autre des deux cas de figure. Il est essentiel de noter que ces "attitudes psychiques" qui, cependant, déterminent le sort des pulsions et des conduites instinctuelles n'ont pas le caractère concret de ces pulsions, des instincts, comme des désirs et des craintes qui leurs sont annexés. Leur mise en acte et leurs effets sont sans liens directs avec quelque principe de plaisir ou mobilisation pulsionnelle. Si ces comportements abstraits gouvernent éventuellement les pulsions, ils ne participent pas à leur nature et sont totalement autonomes par rapport à elles. Ils induisent cependant, vis à vis d'elles des attitudes psychologiques contraignantes, étrangères à la conscience comme à la volonté (qu'ils motivent ou inhibent), mais nettement caractérisées par leurs effets sur les attitudes vis-à-vis du réel. Ils sont surtout étrangers au caractère concret attribué aux forces agissantes du psychisme ayant une représentation mentale, comme les affects en général. Les affects, les perceptions, les activités et les souvenirs (la mémoire) s'offrent à l'expérience et au regard scientifique avec des matériaux et un contenu sur lesquels se bâtissent les diverses théories psychologiques, analytiques ou non. Il n'est rien de comparable dans le domaine des facultés de connectivité et de comparativité, celles-ci sont en autonomie totale par rapport aux affects comme elles le sont par rapport aux perceptions, aux souvenirs et aux activités considérés en eux-mêmes. (...) 2 - Deuxième partie LA DECOUVERTE DE CLIVAGE ONTOLOGIQUE : LES ETAPES 21 - Roman Jakobson : Le double caractère du langage La bipolarisation dont nous parlons est mise en avant, par cet auteur, dans l'essai de 1956 (1, pp. 43-67), rendant hommage en ces termes au linguiste polonais Kruszewski (1851-1887): "il y a deux opérations fondamentales, sous-jacentes au comportement verbal: la sélection et la combinaison. Dans son ''Aperçu de la science du langage", publié il y a 80 ans mais toujours capital, Kruszewski relie ces deux opérations à deux modèles de relations: il fonde la sélection sur la similarité, la combinaison, sur la contiguïté" (2, p. 137). On choisit les mots et on construit les phrases, ce double comportement linguistique permet de définir la sélection qui implique, entre deux termes alternatifs, la possibilité de substituer l'un à l'autre, équivalent du premier sous un aspect, différent sous un autre; mais c'est en combinaison avec d'autres signes qu'apparaît nécessairement un signe linguistique, lui-même composé de signes constituants: Un signe isolé n'a pas de sens ni de raison d'être. Or, ces simples opérations ressortissent à des attitudes psychiques d'une portée beaucoup plus vaste (là était l'intuition de Kruszewski). "les entités parmi lesquelles nous opérons notre sélection sont mutuellement reliées suivant les formes et les degrés variés que peut prendre la similarité (...): la similitude, l'équivalence, la ressemblance, "l'être comme", l'analogie, le contraste". (2, p. 137.) La sélection est congruente à la métaphore. "Contrairement à la sélection, fondée sur une relation interne, la combinaison implique, sous différentes formes et degrés, la relation externe de contiguïté: voisinage, proximité et éloignement, subordination et coordination". (2, p. 159) La combinaison est congruente à la métonymie. Pour préciser ces comportements abstraits, Jakobson recourt à une illustration expérimentale (1, pp. 61-62): en présence d'un nom servant de stimulus (par exemple hutte) deux prédilections linguistiques se manifestent: la réponse est donnée soit comme substitut (similarité), soit comme un complément (contiguïté), généralement une phrase. Les réponses "cabane", "cahute", sont de l'ordre de la similarité. La réponse adéquate est cherchée dans le langage (relation interne) puisque le patient, sans se détacher du référent, recherche un vocable aussi adéquat que possible. La réponse "a brûlé" est de l'ordre de la contiguïté. En aucune manière le feu ne saurait évoquer ou renforcer spécifiquement l'idée d'une hutte; c'est une métonymie, un rapport extra linguistique (relation externe). De son point de départ, le double caractère du langage, l'auteur nous conduit à la mise en évidence d'une dichotomie qui, dit-il, "s'avère d'une signification et d'une portée primordiale pour comprendre le comportement verbal et le comportement humain en général". Il dira ailleurs: "cette bipartition se révèle très éclairante" et il regrette que "la question des deux pôles, pour sa plus grande part, reste négligée, malgré son importance et sa portée énorme dans l'étude de tout comportement symbolique, normal ou pathologique" (2, p. 117). Deux aspects de sa recherche nous intéressent particulièrement: 211 - Une hiérarchie interactive L'auteur relève avec insistance que cette bipolarisation se répète à l'intérieur d'unités linguistiques de différents rangs. « La sélection, dit l'auteur, concerne les entités associées dans le code mais non dans le message donné. » (1, p. 48) Le code, véhicule des échanges parlés, est donc assujetti aux postulats logiques de la similarité, par opposition au message. Ceci révèle l'inclusion du procès de similarité à l'intérieur du signe (par le signifiant), alors que le référent concerné, objet du message (le signifié) peut être extralinguistique et investi par contiguïté. Nous retrouverons ce double caractère au niveau d'unités linguistiques élargies, également codées sous contrainte. Ainsi, les règles codifiant la construction de phrases régissent la combinaison des mots mais elles ont les caractéristiques d'un code (2, p. 111) . Nous le retrouverons encore au sein d'unités signifiantes plus vastes, voire au-delà du langage, au sein d'unités sémantiques réelles ou virtuelles soumises à une syntaxe, à des lois qui ne sont plus grammaticales mais d'essence psychosociale. 212 - La consécution des ordres contigu/similaire, son importance majeure Ce deuxième point découle de cette étude des aphasies. Nous devons le rappeler parce qu'il a ouvert la voie à Jakobson. L'auteur montre longuement que les aphasies dites motrices (Broca) révèlent à l'examen être un trouble de la contiguïté. Le sujet perd la faculté de former des propositions. Le contexte (la connectivité) s'effondre mais les mots résistent. Au maximum c'est le style "télégraphique" où la similarité est préservée. A l'inverse, dans les aphasies sensorielles (Wernicke) la capacité de construire des phrases (le contexte) persiste mais le patient ne pourra nommer un objet qui lui est présenté, il ne pourra que décrire son usage, nous sommes en présence d'un trouble de la similarité. C'est la contiguïté qui est ici préservée (1, pp. 49 à 61). De cette étude Roman Jakobson conclut que ces comportements abstraits de sélection et combinaison sont placés dans une séquence opératoire déterminée et dans un ordre nécessaire (2, pp. 142 sq. et 163 sq.). La consécution, dit-il, est inversée selon que l'on a affaire à une opération d'encodage ou de décodage, c'est-à-dire, selon que l'on est locuteur ou destinataire. Celui qui s'exprime sélectionne les éléments avant de les combiner en un tout; la construction des contextes se fait dans une étape seconde. Par contre, pour l'auditeur, c'est l'ensemble qui est à saisir et qui s'impose en premier lieu; le contexte et le repérage de la combinaison des éléments précèdent l'identification des constituants qui est pour lui une étape seconde. 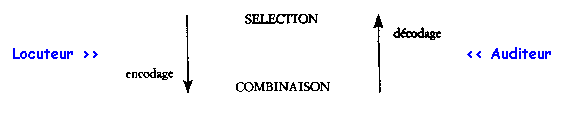 in langage enfantin et aphasie. Selon, donc, que le sujet est agent (locuteur) ou patient (auditeur) les facultés maîtresses de comparativité et de connectivité sont mises en jeu dans une consécution inverse sur le champ commun de l'échange linguistique. Peut-on être simultanément encodeur et décodeur, agent et patient sans risque d'une perte de sens? Peut-être trouvera-t-on là une voie de recherche propre éclairer d'éventuelles conséquences psychopathologiques de ce phénomène. 213 - Résumé En résumant les acquis de Jakobson, nous relèverons: En premier lieu la reconnaissance des opérations linguistiques "sélection-combinaison" comme l'expression de fonctions beaucoup plus vastes. Elles ont une traduction bien connue dans la rhétorique (métaphore/métonymie) et au-delà, gouvernent l'aménagement des unités sémantiques de différents rangs. L'auteur déborde le seul point de vue de la linguistique. Il note que la situation concrète des personnes modifie le contexte puisque l'échange immédiat de paroles impose une forme de contiguïté alors que la séparation dans le temps et dans l'espace implique une relation interne (similarité) (1, p. 49). Il amène ici le questionnement au niveau des relations psychosociales. En second lieu, il note que les unités linguistiques s'aménagent dans une sorte de hiérarchie toujours régie par cette bipolarisation qui prend ici un caractère interactif, depuis le signe le plus simple jusqu'aux unités les plus vastes. En troisième lieu, il relève que c'est la position d'agent ou de patient par apport au message qui détermine, à l'origine, l'action directrice de l'une ou l'autre des deux facultés maîtresses. 22 - Lucien Sebag, l'exclusion mutuelle des deux procès Lucien Sebag introduit un changement de niveau dans ce domaine de recherche (Vers un texte abrégé par ce lien). Cet auteur s'attache à la mise en lumière des rapports de contiguïté et de similarité dans le dévoilement du réel. Il fonde son étude sur un mythe amérindien et fait apparaître non seulement les deux pôles dont nous parlons, mais encore et surtout, le caractère mutuellement exclusif des deux procès avec toutes ses conséquences aux plans individuels, sociologiques et cosmologiques. Il ne s'agit plus d'une simple structure bipolaire, comme l'entendait Jakobson. Il s'agit d'un antagonisme générateur de l'ordre humain. Voici comment Sebag, sans autre commentaire, introduit cette problématique: "Aux deux soeurs (héroïnes du mythe) le végétal est donné sous forme de graine, l'animal sous forme d'une petite statuette le représentant. De l'un à l'autre l'opposition est complète". "La graine c'est la plante non encore développée mais qui, de son propre mouvement, deviendra plante achevée. Entre la graine élément réel du monde végétal et la plante tout aussi réelle mais différente d'elle, existe un rapport de contiguïté. Nous le qualifierons, par convention, de rapport métonymique. Par contre, l'image, la figure ressemblent à l'animal achevé, mais elles ne possèdent pas la même réalité que lui, le passage de l'image à son modèle ne peut se faire de lui-même mais implique l'intervention d'un moyen terme (la parole). Cette relation peut être définie comme métaphorique" (3, p. 27). Les graines et les figures animales dont il est question sont contenues dans deux paniers donnés par le père créateur à chacune des jumelles pour achever la création et ordonner le réel. Le déroulement du mythe obéit à l'opposition incompatible métonymie / métaphore: "création des végétaux et création des animaux vont s'opposer terme à terme. La première implique la combinaison d'un élément réel, la graine, et d'une action directe, le fait de planter. Pour la seconde, il n'y a rien de réel à l'origine, mais seulement une image qui devient vivante grâce à une action linguistique" (3, p. 29) (métaphorique). Ainsi, dans l'aménagement de la réalité, sont clairement révélées les modalités de mise en oeuvre des comportements abstraits dont nous parlions. La combinaison d'un élément réel et d'une action réelle (action directe) est d'essence métonymique. L'action linguistique, congruente à la similarité, est d'essence métaphorique. Deux exemples parmi d'autres illustrent l'opposition des deux procès: * La naissance de Pishuni, le serpent qui allait apporter la maladie aux hommes. Par inadvertance, les jumelles ont laissé tomber à terre la figurine le représentant. Elle devient alors vivante par le contact avec le sol (comme une plante) et non par la parole. Cette naissance correspond donc à une subversion des rapports entre métonymie et métaphore. Ce même serpent tentera l'une des jumelles et l'amènera à procréer en violation de l'ordre établi. * Naissance de Koshari. Il ne restait plus au fond du panier qu'un élément indiscernable. Les jumelles décident de lui donner naissance par la parole. Vient au monde un être humain, mâle, qui était comme fou. Ses phrases étaient dépourvues de signification et il parlait à l'envers. Il sera le patron de la lignée des clowns cérémoniels aux fonctions complexes. * La guerre des Katchina. Ce troisième exemple illustre une autre modalité de subversion des ordres. Le résultat spécifique en sera l'appropriation par le terme inférieur (l'homme) des pouvoirs jusqu'alors détenus par le terme supérieur (les divinités). Les Katchina sont des divinités intermédiaires créées pour aider les humains après le départ de la mère primitive. Vivant au milieu d'eux, elles échangent avec eux leur nourriture et sont donc en rapport métonymique. Pour éviter toute ressemblance, les Katchina portent des masques que les hommes ne doivent pas représenter, car ce serait les imiter. Certains hommes commirent une faute et imitèrent les Katchina, ce qui est une métaphorisation. Il s'en suivit une guerre et les hommes virent des morts pour la première fois. Après le sacrifice d'une partie de la jeunesse, les Katchina se retirent, laissant aux humains la faculté de fabriquer des masques et de s'approprier le pouvoir qui leur est attaché. Le mérite de Lucien Sebag ne se résume pas à la mise en évidence de l'antagonisme du contigu et du similaire. L'auteur précise comment ce clivage ontologique régit la mise en forme de l'individu humain, de sa société et de son cosmos. "La quête de l'humanité se caractérise par une intériorisation et une métaphorisation progressive de l'ensemble des êtres avec lesquels les hommes sont en relation" (3, p. 135). Cette métaphorisation progressive est nécessairement le fruit d'une série de ruptures portant sur des relations métonymiques préexistantes. Ainsi, au prix de crises subversives, les rapports de similarité se substituent à des rapports de contiguïté qui unissaient précédemment les termes en cause. * A l'origine, cette dichotomie est voulue par le dieu créateur. Il crée la terre par un caillot de son sang ce qui est une métonymie (partie d'un même ensemble) et les jumelles à son image ce qui est une métaphore (abstraction de caractères communs) mais tout contact avec le créateur est exclu. Les crises nous intéressent particulièrement. Comment sont-elles résolues? Puisque "la norme n'est pas la disjonction mais au contraire la conjonction" (3, p. 469). D'emblée, on apprend que le contact du même au même est impossible. Deux êtres semblables ne doivent pas se rapprocher: ainsi les jumelles et le créateur. Deux êtres devenus semblables doivent s'éloigner: ainsi les Katchina quittent les hommes quand ceux-ci purent les imiter. Ainsi, Iatiku (la mère primitive) s'éloigne et laisse une symbolisation d'elle-même, quand les jeunes irrespectueux se moquent d'elle et l'imitent. La proximité implique la différence ou des prédicats psychologiques distincts: ainsi les Katchina portent des masques quand ils sont parmi les hommes. Les crises sont le fait de confusions des ordres, plus précisément de la concurrence des ordres sur un même objet, comme le montrent les naissances du serpent et du Kochare. Autre exemple, la faute des jumeaux: ils ont confondu la chasse et la guerre, traité les humains (qui sont des végétaux) comme des animaux. Ils ont donc frappé l'ordre végétal tout entier, il s'ensuivit une sécheresse. Notons que les humains "sont des végétaux", c'est-à-dire que le rapport de l'homme à l'humain est de l'ordre de la métonymie. Pour preuve l'admirable analyse de la faute de Nautsiti (cliquer ici pour détails) qui montre que la distance spatiale vaut pour la distance temporelle en regard du contigu ou du similaire. Les crises sont donc engendrées soit par des fautes (naissance de Pishuni), soit des erreurs (naissance de Koshari) dans la distribution des ordres, soit par le rapprochement de ce qui doit normalement être éloigné à cause de caractéristiques communes acquises ou préexistantes (Katchina). Après transmission de pouvoirs d'un terme supérieur vers le terme inférieur, aucune proximité n'est possible. "les relations se brisent après une confusion entre la métonymie et la métaphore qui oblige le terme supérieur à se retirer" (3, p. 120) mais, "le terme supérieur en disparaissant laisse toujours plus de lui-même". Uchtsiti se retirant, les jumelles ne possèdent-elles pas seules le pouvoir de continuer la création? Quand les Katchina se retirent, les hommes possèdent le pouvoir des masques. Dans tous les cas, une progression générale est faite d'une suite de ruptures dont les caractéristiques communes sont d'annuler une contiguïté préexistante et d'engendrer perte, abandon, deuil, prix à payer de l'acquisition d'un statut nouveau, toujours plus comparable à celui du créateur. La notion de faute, on le devine, apparaît extrêmement importante. Le point qui nous paraît ici capital est qu'elle contient une réversibilité particulière que nous formulerons ainsi: il n'y a pas de transformation sans crise, marquée par la subversion fautive (qui porteuse de crise, permet en retour une transformation). Peu importe que la faute soit celle des dieux ou celles des hommes. Retenons donc trois faits importants: a) la crise est à la fois la condition et l'occasion de la transformation; b) les acquisitions se font toujours dans le même sens et sont irréversibles; c) les ruptures concomitantes sont aussi irréversibles que la mort. Le père créateur se retire après la faute des jumelles, la mère primitive se retire après la faute des moqueurs (la mort est nommée pour la première fois) et de la même manière les Katchina (le peuple voit des morts pour la première fois). Ces deuils sont corrélatifs de l'acquisition d'un pouvoir nouveau prélevé sur le terme civilisateur (père ou mère mythique) et nous pouvons constituer le schéma suivant:  Cette mise à jour capitale n'épuise pas l'oeuvre de Lucien Sebag. Perte, deuil ou mort ne sont pas les conditions exclusives de la légalisation, elles sont corrélées à trois procès principaux: 221 - La symbolisation... "A la connexion initiale des éléments réunis en un seul point, doit faire place à un autre type de relations puisque l'isolement absolu n'est pas possible (les hommes ont besoin des végétaux, des animaux, des dieux". (3, pp. 472-473) Mais, dit Lucien Sebag: "...le pouvoir humain véritable réside dans la symbolisation. ... Au terme du parcours, les hommes ... sont capables ... de synthétiser toute la diversité du réel. Cette opération n'est possible que par la médiation du symbole ... Il n'y a pas d'autre appropriation du monde que celle qui passe par la médiation des signes." (3, p. 473). Ce procès légalisateur paraît étroitement lié au dédoublement gémellaire. 222 - ...et le double qui lui est assimilable Lucien Sebag note le rôle éminent des jumeaux, comparable à celui des êtres subversifs. Ne sont-ils pas totalement contigus et totalement similaires? Curieusement Lucien Sebag ne relève pas ce caractère, mais il note leur pouvoir de transformer les relations du contigu vers l'imitatif en contournant les crises. Ce processus, presque constamment à l'oeuvre dans les activités humaines, (voir mouton d'à côté) est très reconnaissable dans nombre de démarches thérapeutiques. Nous sommes ici devant une question ouverte méritant une étude spéciale. 223 - La subversion Quant aux personnages subversifs, leur ambivalence semble les rapprocher des jumeaux. Ils se tiennent à la confluence de domaines normalement distincts et, à ce titre, peuvent transformer le contenu des relations. Tous y contribuent à un moment où un autre du mythe. Tous confondent métonymie et métaphore: Pishuni et Kochari par leur naissance même, d'autres par leur attitude (Gaukapuchume) ou par leurs attributs (Gomaiowish) (3, p. 179). Sebag relève que ces êtres subversifs se caractérisent tous par une déformation de l'activité linguistique (3, p. 180). - Tous les animaux ne parlent que pour poser des questions, le serpent Pishuni est le seul à ne pas pouvoir, non seulement interroger, mais répondre, expliquer, ce qui lui permet de tenter Nautsiti. - Koshari inverse toutes les significations. - Gomaiowish est un messager qui s'arrange pour ne pas annoncer l'événement essentiel, l'attaque des Katchina. - La "tête de bébé, possession de Gaukapuchume pousse des cris affreux qui provoquent la terreur" (3, p. 180). Pour les trois premiers, au moins, l'inversion linguistique est donc clairement corrélée avec l'inversion des ordres. 224 - La différence C'est par prétérition que Sebag désigne la différence comme un facteur fondamental de coexistence. Ce point essentiel n'est pas relevé comme tel dans le courant de l'analyse structurale. Mais la nécessité de ne pas se ressembler, l'impossibilité d'imiter ou de se donner à imiter, le danger d'égaler sur un même espace pertinent de contiguïté, surgissent avec une clarté aveuglante, entièrement régis par les comportements abstraits. On saisit pourquoi la castration, en modifiant la similarité, permet à la fois inclusion et subordination, et contribue ainsi à résorber la tension oedipienne. Le lecteur averti des faits psychopathologiques n'aura pas manqué de relever des recoupements saisissants avec la problématique qui lui est familière. Que l'appropriation des formes du terme supérieur par le terme inférieur implique crise, deuil, mort ou abandon, voilà qui jette un jour nouveau sur la question centrale de l'oedipe. Du même coup, à côté de la symbolisation, d'autres solutions apparaissent. L'une des plus évidentes est la ressemblance altérée, autrement dit la différence, qui permet une forme de coexistence. Ici un domaine de recherches se pose devant le concept général de castration. Dès maintenant, nous pouvons entrevoir divers avatars. Que peut-il advenir, par exemple, lorsque la ressemblance altérée (la castration) est niée, déniée ou refusée (déni)? La crise peut cesser d'être un moment pour devenir un état, plusieurs cas de figures étant possibles: - l'affrontement permanent paranoïaque au sein d'une contiguïté effervescente; - l'inversion signifiant-signifié, c'est-à-dire la psychose (cf.....)(1); - le dédoublement pervers du langage (per-versus), détourné de sa fonction unifiante (uni-versus). Le sujet n'a "plus de parole". C'est bien évidemment vers le freudisme qu'il faut regarder pour approfondir les conditions d'apparition de telle ou telle éventualité, non sans s'étonner de la capacité d'anticipation du Maître viennois. 3347 Note sur la métonymie: cliquer ici. Où il apparaît que le tabou de l'inceste est la contradiction interne du concept de métonymie. (1) [Note de JPM: La référence est absente. Bien que cette notion d'inversion soit constante dans la compréhension des psychoses ici présentée, je n'ai pas trouvé de référence précise quant à l'inversion signifiant-signifié. La référence la plus proche est: L'hallucination est-elle l'inversion du signe? in L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 61, 2, 1985.] 3 - Troisième partie TOUS LES PLANS DE LA REALITE 311 - Au plan cosmologique: Les religions. 1) L'ancien testament. - La Genèse offre certains aspects comparables au mythe d'Acoma. Le couple primordial, dans le jardin d'Éden se trouve en contiguïté parfaite avec le Créateur. Il vit dans le même verger, respire le même air. Il est fait à l'image du Père. On relève cependant une différence qui permet la coexistence: ce couple n'est pas créateur et n'a pas la connaissance du bien et du mal, apanage de la nature divine. Le serpent leur dit: "vous serez comme des dieux". Cette invitation à la ressemblance provoque trois conséquences: - la mort, le couple devient mortel; - la distance, conséquence de la chute; - la ressemblance accrue au Créateur, qui est alors possible: Adam et Eve deviennent créateurs à leur tour et comptables de la discrimination du bien et du mal. 2) Le Nouveau Testament et l'institution du nouvel ordre du monde par le Christ. - En premier lieu, la contiguïté fonde les rapports du Christ avec les hommes: Jésus naît de mère humaine et appartient totalement à la communauté des hommes. Dans le même temps, il se place en similarité totale avec l'humain. Il épouse les angoisses humaines au mont des Oliviers. Sur la Croix, il souffre dans sa chair et "selon toute son âme". S'il est totalement Dieu, il est totalement homme et la corruptibilité de son corps avant le troisième jour est une exigence théologique. Satan oeuvre pour contraindre le Christ à s'abstraire de son humanité. Mais Jésus, au désert, refuse les prodiges (transformer les pierres en pain, se précipiter de la hauteur) afin de ne pas se distinguer de la condition humaine et de demeurer dans la similarité. Le Christ, signe de contradiction, énonce un discours fondateur. Pour ceux qui admettent que sa parole vient d'ailleurs, d'un tiers, c'est à dire le Père il sera fils de Dieu. Les autres le récuseront, convaincus qu'il parle d'autorité. Par une fondamentale cohérence, le meurtre des uns est nécessaire à la foi des autres, puisque le sacrifice transforme des relations préexistantes. Notons et cela est capital que, cette fois-ci, mort et douleur affectent le terme supérieur (divin) et non le terme inférieur (l'humain). Le résultat sera un remaniement systématisé par rapport à l'Ancien Testament ainsi que nous voulons le faire comprendre par le tableau ci-après: |
|
Katchina |
Ancien testament |
Nouveau testament | |
|
Terme imitant |
Humain |
Humain |
Divin |
|
Terme imité |
Divin |
Divin |
Humain |
|
Terme frappé par la mort |
Humain |
Humain |
Divin |
|
Devenir humain |
Mort |
Mort |
Résurrection |
|
Corrélativement |
(faute) |
(faute) |
( rachat) |
| La cohérence saute aux yeux et l'on
perçoit que l'inversion des attitudes imitant-imité
provoque un renversement total
de l'ensemble systématisé dans
les plus ultimes conséquences. Lorsque l'action imitatrice est le fait du Dieu vivant (Nouveau Testament), et non des hommes, leur mort est abolie. Dans la Genèse et la guerre des Katchina le mouvement est totalement contraire. Ainsi, peut-on relever ici, par un examen même sommaire: - l'irréversibilité du processus transformateur; - la cohérence des systèmes structurés puisque l'inversion de l'un des termes se répercute sur la structure tout entière; - l'importance primordiale du sacrifice, de la distanciation et de la faute. Trois phénomènes différents dans leur nature, intimement liés, sans être nécessairement conjoints sur le même être. 312 - Le plan sociologique: La patrie. Nous proposons un exemple de sacrifice fondateur fortement interne à nos jugements. La Patrie est le lieu d'où nous tirons notre identité dont des traits pertinents fondent les caractères communs qui nous désignent dans notre nationalité. La Patrie est aussi un ensemble déterminé, lieu et terrain d'un enracinement métonymique. Comment cette convergence du contigu et du similaire se résout-elle? Par la plus dure des lois: la mort. La Patrie est le lieu du sacrifice humain institutionnalisé. Ce sacrifice est fondateur: l'époque contemporaine a vu se fonder plusieurs nations dans le sang (des héros ou des victimes expiatoires = Algérie, Vietnam). Nos monuments aux morts ne sont-ils pas les autels de la patrie? Notons que nous ne prétendons pas apporter ici une théorie de la guerre mais plutôt rendre compte de la fonction guerrière et de son intégration par les êtres. 313 - Le plan individuel: L'échange sexuel. Le discours amoureux. Après la folie collective qu'est la guerre, nous n'ouvrirons pas un chapitre sur la folie des êtres en tant que pathologie mentale. Plus faciles d'accès seront les perturbations linguistiques du discours amoureux. Par rapport aux névroses et psychoses, le discours amoureux est une miniature de tous les procédés d'inversion, de déni, de résistance et de déplacement. Mais notre propos n'est pas de nous engager dans cette analyse; il est de toucher du doigt la subversion introduite par la confluence des ordres distincts, le contigu et similaire, sur une même réalité. Les paroles de l'amour et sur l'amour sont subversives. Ceci leur confère leur saveur particulière mais tous les effets ne sont pas plaisants ou poétiques. Qui n'a entendu ce dialogue: "il ne sait pas dire: je t'aime"; "il ne me le dit jamais", "c'est vrai je ne peux pas le dire". Pourquoi ne peut-il pas le lui dire? Pourquoi ne peut-il que répondre: "elle sait bien que je l'aime"? L'échange sexuel réunit dans le couple tous les aspects d'une contiguïté sociocorporelle: a) parce qu'il exige la proximité du contact; b) parce qu'il est une action réelle combinée à un élément réel; c) parce que sa prise en compte sociale réunit les partenaires dans un même ensemble. La vie amoureuse a pour support un acte corporel dont les motifs et les effets n'ont pas besoin d'être nommés pour exister. Mais la pulsion rencontre son objet par le moyen d'un message qui doit rencontrer la personne de l'autre. La personne dans son identité sociale est un être linguistique et ce message a besoin d'un langage. Certes, il peut advenir que ce message contourne le langage: Mimiques et gestes peuvent se substituer efficacement à la parole pour le but proposé. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il s'agit de parler de l'amour pour le faire, il y a déformation de l'activité linguistique et ceci nous intéresse puisque nous sommes sur la conjonction de la parole et de l'acte corporel, autrement dit, à la confluence de ce qui doit être normalement séparé (et qui l'est, dans les phases les plus intenses). Si des gestes phoniques peuvent accompagner l'acte amoureux, le bavardage n'y est pas de mise et on sait que l'orgasme s'accommode mal de la parole. La coupure contigu / similaire est ici radicale. La "parade amoureuse" de l'humain est riche d'intérêt parce qu'il faut bien parler; mais le langage, s'il n'inverse pas sa finalité, comme dans le délire, se voit inversé dans sa signification objective. Le dialogue amoureux est l'exemple même d'un discours à l'envers: Le silence tient lieu de parole, la parole tient lieu d'écran, alors que le message implicite est parfaitement entendu, le message explicite passera par tous les détours qui, du "baratin" à l'amour courtois, sont le terrain d'élection de la littérature, de l'art dramatique ou du cinéma. Des propos très près des faits, très sexuels ont peu de chance d'atteindre leur but. Mais on doit retenir un autre aspect: Qui ne connaît des couples qui, après de nombreuses années de vie commune, ne sont jamais parvenus à échanger réellement sur ce sujet. Il est très banal que des partenaires n'aient jamais pu exprimer une émotion particulière ni un désir particulier cependant très présents dans leur discours intérieur, dont l'écart est ici immense avec le discours exprimé. Certes, tel n'est pas toujours le cas, mais en regardant de près, on rencontrera toujours, dans ce domaine de la sexualité, ce point indépassable où l'expression verbale ne peut plus rendre compte d'un désir, cependant bien présent. Il y aurait aussi à examiner les conditions dans lesquelles la parole se libère sur la chose sexuelle, il semble que cela survienne quand les partenaires sont moins impliqués, quand leur contiguïté est occasionnelle, extraconjugale, etc.. Il en est de même quand le processus d'inversion se porte ailleurs. Nous avons ici en vue le retournement sadomasochiste qui transforme le plaisir reçu en douleur et le plaisir donné de tendresse en violence. Il semble que, dans ces cas, la parole puisse être de la fête et totalement libérée. Ne peut-on conclure que la normalisation de la fonction linguistique est acquise ici au prix d'une inversion pure et simple de la finalité psycho sensuelle de l'acte amoureux qui est normalement le plaisir? Nous ne prétendons pas épuiser ici la question du comportement érotique, nous souhaitons illustrer sommairement, et par des exemples pris très près des personnes, une problématique très générale. Brièvement nous évoquerons aussi un aspect symétrique et inverse qui est celui du dépérissement de la vie sexuelle survenant, avec le temps, entre des partenaires habituels. Ce temps, c'est le temps nécessaire à une riche information réciproque, à une connaissance approfondie de l'autre. Mari et femme devenant tels des frères et soeurs se trouvent moins motivés sexuellement qu'à l'époque où ils se connaissaient moins ou peu. Cette assimilation de l'autre vaut pour une similarité. Elle fait donc obstacle à la contiguïté. Ainsi, peut-on rendre compte de la pathologie des couples ou des solutions mises en oeuvre dont la plus évidente, tout comme pour le langage, est le recours à un tiers (amant, maîtresse ou aventure, solution parfois "institutionnalisé" en échangisme). On sait encore que l'apport de fantasmes érotiques, pendant l'acte, peut réaliser un dédoublement efficace du partenaire lequel aura tout à gagner à cette manoeuvre imaginative de son conjoint. Enfin, restent aussi des couples pathologiques qui fonctionnent bien sexuellement, qui communiquent bien sur ce sujet mais qui transfèrent dans leur vie quotidienne la négation réciproque ou la crise permanente, réglant à leur manière, et par l'enfer à domicile, le problème du péché originel. 32 - L'autonomie des facteurs d'antagonisme L'occurrence de l'activité linguistique sur le lieu de l'acte corporel induit une problématique d'inversion. La localisation de cette inversion est sujette à déplacement sur un point quelconque mais non aléatoire de l'axe syntagmatique de l'accomplissement pulsionnel. Elle peut se situer: - au niveau du plaisir (sadomasochisme), - au niveau du langage (oui = non), - au niveau du comportement (couple pathologique). Cette faculté de déplacement témoigne de l'autonomie des facteurs d'antagonisme (clivage ontologique) en regard du langage aussi bien qu'en regard des pulsions, puisque le jeu des comportements abstraits peut inverser, en la personne, aussi bien l'expression linguistique que l'expression corporelle. |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. Dr J. Morenon, F-04500 RIEZ |
 |