
 |
Sciences du langage D'après L'hallucination
est-elle l'inversion du
signe? in L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 61, 2, 1985. |
Préambule Un discours intelligent mais non intelligible L'exigence d'un contrat à l'envers Problèmes de cohérence scientifique Ensembles signifiants Préambule : Une étonnante méconnaissance. En dépit de remarquables avancées dans les sciences de l'esprit, l'humain demeure curieusement ignorant de l'une des bases essentielles et fondatrices de son comportement psychologique : une inaptitude absolue à gérer la ressemblance dans la proximité. Phénomène mineur, dira-t-on ? Nullement. Il s'agit d'un antagonisme constitutif de l'ordre humain. Dès l'antiquité deux ordres distincts dans les rapports que l'humain entretien avec la réalité ont été reconnus. Ils sont décrits par Aristote, à propos de la mémoire, en termes de relation de contiguïté et relation de similarité. Toutefois, plusieurs millénaires furent nécessaires pour que soit perçu un phénomène connexe : la mutuelle exclusion de ces deux modes de connexion avec la réalité. (Références, voir : L'analogique et le contigu) Les conséquences considérables psychologiques, individuelles et sociales de cet antagonisme sont à peine reconnues, à peine explorées et leur défrichement constitue un immense chantier. Qu'il suffise de dire que cette irréductible opposition est au coeur du l'antagonisme oedipien, du tabou de l'inceste, et affecte les rapports que peuvent entretenir, réciproquement nos actes corporels et notre langage (cf. la pudeur). Nous allons retrouver ce clivage au coeur des phénomènes hallucinatoires. La psychose : un discours intelligent mais non intelligible Dans l'étude des psychoses, il apparaît de nos jours légitime d'interroger la linguistique. Mais avant tout approfondissement, cette discipline nous dit que le sens donné à nos propos résulte d'un échange de vocables. Cet échange se fait à partir d'un consensus concernant l'ensemble des signes du langage : ainsi s'établit la compréhension entre les êtres. Chaque interlocuteur puise dans un catalogue de "représentations préfabriquées". La parole émanant du sujet parlant est alors reconnue par le, ou les auditeurs. En fait, on pense dans un choix de possibilités déjà établies, qui préexistent à l'acte de parole. Il n'est accordé valeur de vérité qu'aux objets mentaux pourvus d'un sens au sein d'une culture ; ainsi un discours intelligent est-il intelligible. Il est des personnes singulières, avec qui l'échange de paroles aboutit à un effet inverse, la non compréhension. Devant cette singularité, la psychiatrie a pour tâche de repérer et classifier l'invraisemblance du discours. S'il n'y a pas ruse, mensonge, ignorance ou mystification, il y a psychose. Certes le psychotique peut respecter la grammaire et, sans altérer les mots, s'exprimer dans un langage intelligent. Mais ce langage n'est pas intelligible. Ainsi, dans ces affections, le langage paraît-il détourné de sa fonction première pour obéir à une autre finalité : une incompréhension tenace entre les êtres. L'exigence d'un contrat à l'envers L'opinion la plus courante est que la psychose se manifeste dans ce renversement de sens. Mais deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène :
Autrement dit, ce ne serait pas, une idée anormale qui inverserait le bon sens mais l'impossibilité d'entrer dans le consensus dont nous parlions. Ce qui est tout autre chose mais qui, plus sûrement encore, rend inaccessible le discours du délirant. La clinique paraît apporter la preuve de cette hypothèse, puisque quiconque accepte le récit du psychotique voit s'y développer aussitôt l'escalade et la boursouflure des idées maladives. En conséquence, le thérapeute prend grand soin de ne jamais accréditer les dires du patient, ce qui, curieusement, garantit la fidélité de la relation. Réinterrogé sous l'angle de la linguistique, ces faits suggèrent :
Problèmes épistémologiques Les sciences du langage ont pénétré notre discipline grâce à J. Lacan. Mais si l'on était en droit d'attendre, sous sa plume, des hypothèses complémentaires et l'élaboration de sens nouveaux, on doit constater que le remaniement opéré ne conserve des concepts d'origine que leur apparence, ce qui ne manque pas de dérouter les chercheurs. On note cependant, dans ses travaux, un incessant effort pour s'enrichir de la linguistique. Avec les notions de signifiants fondamentaux, de signifiants collatéraux, Lacan donne réalité à des unités mentales élargies, à des ensembles signifiants, notions émanées de la linguistique structurale et que nous tenons pour opératoirement valables. Toutefois, jeter un pont entre les continents "linguistique" et "psychiatrie" implique surtout d'éviter certains glissements épistémologiques. Ainsi l'inclusion des notions linguistiques de signifiant et de signifié au sein de la psychanalyse suppose : - de démêler, par exemple, ce qui est imputable aux lois du concept "père", tel que la psychanalyse l'appréhende, - et ce qui est imputable aux lois du signifiant saussurien correspondant. L'insertion du concept "père" dans le signifiant du même nom ne peut s'opérer qu'à partir des lois imputées à un ensemble signifiant considéré comme tel. "Ensemble signifiant" implique un pas de plus et conduit vers les notions d'ensembles extensifs et d'ensembles compréhensifs. Le recours à ces notions a pour intérêt principal de permettre la représentation des données étudiées, en particulier freudiennes. Mais au risque de tourner en rond et ne faire apparaître autre chose que préalablement mise, les ensembles signifiants doivent être considérés en dehors des lois de la psychanalyse, le problème étant : - d'une part de dégager des ensembles signifiants, compatibles avec la théorie analytique, - d'autre part de raisonner sur ces ensembles conformément aux lois qui les régissent. Cette reprise scientifique appelle donc : - que les unités signifiantes soient construites d'après les données freudiennes ; - mais aussi que ces ensembles pertinents soient significatifs au plan linguistiques. Ensembles signifiants A juste titre, le signifiant fondamental "père" est étudié par Lacan. Cet auteur distingue le père, Monsieur Untel, le père génital et le nom du père qui représente les injonctions sociales. Cependant on notera, qu'en tant qu'unité signifiante, cet ensemble fonctionne sous deux modes distincts (agent ou patient) que met en conflit la chronologie du développement personnel : avoir un père et être père. (Conflit synchronie / diachronie). "Etre père", des psychanalystes, forme un ensemble dans lequel on peut lire autant de signifiants collatéraux à cette notion. Ces éléments sont liés par des rapports de contiguïté (avoir une épouse, avoir un métier, avoir des enfants, avoir un domicile, etc.). C'est leur regroupement dans ce même ensemble qui fonde le signifiant fondamental "être père". 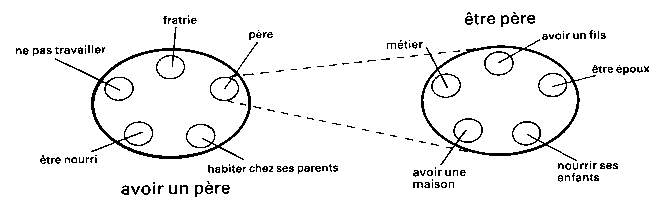 "Avoir un père" (être fils) institue un autre ensemble doté de signifiants collatéraux qui connotent les mêmes êtres : avoir des frères et soeurs, avoir un père, habiter chez ses parents... Ces éléments collatéraux, comme dans le cas précédent, sont unis par contiguïté. Mais parmi les éléments collatéraux qui le composent, l'un d'entre eux revêt une importance particulière : c'est celui du "père" qui ne saurait être absent. Il ne peut être que la réplique de l'élément signifiant "être père". Composé à l'identique, il renferme les mêmes éléments collatéraux que "père", qui participe à "être fils" dans une situation de contiguïté. Les éléments de la crise sont si bien contenus dans cette configuration que nous pouvons reformuler la question première : comment échappe-t-on à la psychose ? |
| >> suite |
| Sur les bases théoriques voir recherche en psycholinguistique. |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |
 |