
 Format pdf
Format pdf |
| Recherche en
psycho-linguistique |
| L'analogique et le contigu (3/3) |
| R. Jakobson : les comportements abstraits |
 Format pdf Format pdf |
| Dans l'échange linguistique, les
facultés maîtresses de connectivité et de
comparativité sont mises en jeu dans une consécution inverse, selon que l'on est auditeur ou locuteur. |
| Divisions du texte : - 1er article : - Les sources : R. Jakobson - 2ième article : - La question des deux pôles - 3ième article : - Encodage et décodage Chapitres : 1) encodage et décodage d'une séquence linguistique 2) une consécution inversée dans l'écoute et l'acte de parole Encodage et décodage d'une séquence linguistique Cette étude met sur la voie d'une hypothèse développée par l'auteur qui analyse les opérations de décodage et d'encodage, leurs perturbations lui paraissant être le trouble dominant dans chacune des formes d'aphasies : "la différence entre troubles de la combinaison (aphasies motrices de BROCA) et troubles de la sélection (aphasies sensorielles) coïncide étroitement avec la différence entre perturbation de l'encodage et du décodage". Il conclut que ces "comportements abstraits" de sélection et de combinaison fonctionnent dans une séquence opératoire déterminée et dans un ordre nécessaire. L'encodage commence par la sélection des constituants qui sont ensuite combinés et intégrés dans un contexte. La sélection est l'acte initial. L'élaboration du contexte, qui est le but de l'encodeur, intervient secondairement. Pour le décodage, l'ordre est inverse. Le contexte est perçu en premier lieu et les données sont reçues déjà synthétisées pour l'auditeur. C'est ensuite qu'une opération d'analyse identifie les constituants. L'encodeur "commence par une opération d'analyse suivie de synthèse ; pour le décodeur l'ordre est inverse". Il reçoit "les données toutes synthétisées et procède alors à leur analyse". Voici un exemple donné par Jakobson : si l'on parle d'un banc, l'encodeur sait de quoi il s'agit. Le décodeur doit connaître le contexte pour savoir si le discours se réfère à un banc de poisson ou à un siège. Dans les troubles aphasiques : C'est le conséquent qui est détérioré et non l'antécédent qui demeure intact. Ainsi dans l'aphasie de BROCA, qui est un trouble de l'encodage, c'est la combinaison qui est perturbée. Il y a effondrement du contexte et agrammatisme, alors que pour l'aphasie de WERNICKE, qui est un trouble du décodage, c'est la sélection qui est défectueuse. Il y a impossibilité de nomination mais persistance de la combinaison des phrases. La combinaison qui a pouvoir d'investiguer et de construire le contexte est donc déficitaire dans les aphasies d'encodage (BROCA). La sélection qui a pouvoir sur l'action nominative est détériorée dans les aphasies de WERNICKE. Une consécution inversée dans l'écoute et l'acte de parole L'étude des aphasies vient confirmer cette hypothèse que, dans le fonctionnement normal, la consécution des ordres, sélection / combinaison est inversée selon que l'on a affaire à une opération d'encodage ou une opération de décodage. Elle l'est donc nécessairement selon que l'on est locuteur ou destinataire d'un discours, selon que l'on parle ou que l'on écoute. 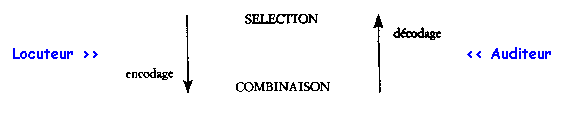 Celui qui s'exprime sélectionne les éléments avant de les combiner en un tout ; la construction des contextes se fait dans une étape seconde. Par contre, pour l'auditeur c'est l'ensemble qui est à saisir et qui s'impose en premier lieu ; le contexte et le repérage de la combinaison des éléments précèdent l'identification des constituants qui intervient dans une étape seconde. Revenant à notre problématique nous constatons que les facultés maîtresses de connectivité et de comparativité sont mises en jeu dans une consécution inverse, sur le champ commun de l'échange linguistique, selon que l'on est patient (auditeur) ou agent (locuteur). Peut-on être simultanément encodeur et décodeur, locuteur et auditeur, sans risque d'une perte de sens? Une réflexion sur cette question s'avère d'autant plus urgente que : a) le processus est nécessairement réversible ; b) il se répercute sur les unités linguistiques de différents rangs y compris dans l'activité de le pensée. Ainsi pour l'accomplissement de l'acte de parole, chez le locuteur, la configuration correcte suppose la consécution : sélection / combinaison qui est celle de l'encodage. Alors que la consécution inverse de décodage : combinaison / sélection correspond à une configuration d'écoute et paraît exclure l'acte de parole. Ceci donne à penser que l'occurrence d'une situation de similarité comme antécédent implique et induit la position d'agent (et/ou de locuteur), alors que la situation de contiguïté comme antécédent suscite de façon opposée la position de patient (et/ou d'auditeur). Ayant à résumer succinctement les travaux que Jakobson consacre au problème qui nous intéresse nous relevons : En premier lieu la reconnaissance des opérations linguistiques : sélection / combinaison comme l'expression de fonctions beaucoup plus vastes, qui régissent l'aménagement des unités sémantiques de différents rangs. L'auteur déborde le seul point de vue de la linguistique. Il note que la situation concrète des personnes participe au contexte puisque l'échange immédiat de paroles impose une forme de contiguïté. A l'inverse la séparation dans le temps et dans l'espace implique une relation interne de similarité. En second lieu Jakobson observe que les unités linguistiques s'aménagent dans une hiérarchie toujours régie par cette bipolarisation depuis le signe élémentaire jusqu'aux unités les plus vastes. En troisième lieu, il indique une donnée théorique majeure en observant qu'à l'intérieur du circuit de parole : La position de locuteur ou d'auditeur impliquent des consécutions appropriée des fonctions de combinaison et de sélection nous retrouverons cette donnée à propos des hallucinations auditives. La simultanéité parait irrecevable, ce qui laisse pressentir l'exclusion réciproque de la contiguïté et de la métaphore. Cette problématique va s'avérer fondamentale dans la compréhension du comportement pudique, phénomène anthropologique majeur, et dans ce symptôme particulièrement énigmatique que sont les hallucinations auditives. |
| Autres articles liés à ce thème : précisions sur les aphasies Comportement abstrait et contiguïté sexuelle l'activité dirigée vers l'objet |
| Fin |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. Dr J. Morenon, F-04500 RIEZ |
 |