
 Les très riches heures du duc de Berry (musée Condé, Chantilly). | page
précédente
( La pudeur -
XII -) page suivant COEXISTENCES CELESTES |
1 - Le mythe Acoma 2 - Une opposition génératrice de l'ordre humain 3 - Genèse occidentale 4 - Vous serez comme des dieux 5 - Voilà que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous Un regard sur la pudeur humaine renvoie inéluctablement à ces versets de la Genèse que nous avons cités plus haut. On pressent que ce mythe, dont on sait la valeur fondatrice pour notre univers culturel, possède un pouvoir de signification qui se déploie bien au-delà de la question sexuelle. Si la pudeur apparaît comme l'expression d'un conflit qui oppose l'acte corporel à l'acte de parole, la place centrale que lui donne le mythe laisse penser que cet antagonisme obéit à des facteurs sous-jacents allant bien au delà du seul phénomène pudique. On ne saurait les réduire à la simple opposition instrumentale et matérielle entre communication parlée et communication muette. Le mythe d'émergence des indiens Pueblos Un éclairage très important est donné en ce sens par les travaux du chercheur français Lucien Sébag. Ils sont consacrés à une autre histoire culturelle, celle des Indiens Pueblos, mais ce détour va s'avérer riche d'enseignement. L'auteur, élève de Lévi-Srauss, s'est attaché, dans une oeuvre posthume, à mettre en lumière les procès de dévoilement du réel tels que les exprime le mythe d'émergence Acoma. (Les Pueblos sont une population amérindienne dont l'habitat, aux USA, se répartit à travers le Nouveau Mexique et l'Arizona). Les deux procès de sélection et combinaison (tels qu'ils gouvernent respectivement l'acte de parole et l'acte corporel) y révèlent, là comme ailleurs, leur caractère mutuellement exclusif. Ce clivage apparaît à l'auteur comme générateur de l'ordre humain et il en tire toutes les conséquences aux plans individuels, sociologiques et cosmologiques. Ce texte est développé dans Sébag. Lucien Sébag introduit ainsi cette problématique : "Aux deux soeurs (héroïnes du mythe) le végétal est donné sous forme de graine, l'animal sous forme d'une petite statuette le représentant. [Les graines et les figures animales dont il est question sont contenues dans deux paniers donnés aux Jumelles par le Père Créateur pour achever la Création et ordonner l'Univers]. De l'un à l'autre l'opposition est complète. "La graine c'est la plante non encore développée mais qui, de son propre mouvement, deviendra plante achevée. Entre la graine élément réel du monde végétal et la plante tout aussi réelle mais différente d'elle, existe un rapport de contiguïté. Nous le qualifierons, par convention, de rapport métonymique. Par contre, l'image, la figure ressemblent à l'animal achevé, mais elles ne possèdent pas la même réalité que lui, le passage de l'image à son modèle ne peut se faire de lui-même mais implique l'intervention d'un moyen terme (la parole). Cette relation peut être définie comme métaphorique". Dès lors, le déroulement du mythe obéit à l'opposition métonymie/ métaphore, c'est à dire combinaison / sélection : "Création des végétaux et création des animaux vont s'opposer terme à terme. La première implique la combinaison d'un élément réel, la graine, et d'une action directe, le fait de planter. Pour la seconde, il n'y a rien de réel à l'origine, mais seulement une image qui devient vivante grâce à une action linguistique". Ainsi, dès le départ, l'aménagement de la réalité requiert : - soit la combinaison d'un élément réel et d'une action réelle (action directe) d'essence métonymique ; - soit une action linguistique, (parole) congruente à la similarité et d'essence métaphorique. Une opposition génératrice de l'ordre humain Trois exemples illustrent l'opposition des deux procès dont la confluence sur le même objet est uniformément génératrice de crise ou de subversion: La naissance de Pishuni (le serpent) : Par inadvertance, les jumelles ont laissé tomber à terre la figurine le représentant. Elle devient alors vivante par le contact avec le sol (comme une plante) et non par la parole. Cette naissance correspond à une subversion des rapports entre métonymie et métaphore. Ce serpent tentera l'une des jumelles, l'amenant à procréer en violation de l'ordre établi. Naissance de Koshari : Il ne restait plus au fond du panier qu'un élément indiscernable. Les jumelles, non informées, décident par erreur de lui donner naissance par la parole. Vient au monde un être humain, mâle, qui était comme fou. Ses phrases étaient dépourvues de signification et il parlait à l'envers. La guerre des Katchina : Ces divinités ont été créées pour aider les humains après le départ de la mère primitive. Elles vivent au milieu d'eux et sont donc en rapport métonymique. Pour éviter toute ressemblance, les Katchina portent des masques que les hommes ne doivent pas représenter, car ce serait les imiter. Certains hommes commirent une faute et imitèrent les Katchina, ce qui est une métaphorisation. Il s'en suivit une guerre. Après le sacrifice d'une partie de la jeunesse, les Katchina se retirent, laissant aux humains la faculté de fabriquer des masques et de s'approprier le pouvoir qui leur est attaché. 
Katchina, coll. Partic. Photo FMR. Au départ la relation de l'humain à la diversité du réel obéit à la dichotomie action réelle / action linguistique, (congruente à l'antagonisme contigu / similaire). Mais la progression générale du mythe, montre que, au fur et à mesure que se structure la société, le même clivage s'applique à des unités sémantiques élargies qui obéissent donc aux mêmes postulats logiques. "La quête de l'humanité se caractérise par une intériorisation et une métaphorisation progressive de l'ensemble des êtres avec lesquels les hommes sont en relation". Cette métaphorisation progressive est le fruit d'une série de ruptures portant sur des relations métonymiques préexistantes. Ainsi, toujours au prix de crises subversives, les rapports de similarité se substituent à des rapports de contiguïté qui unissaient précédemment les termes en présence. En voici un exemple : A l'origine, cette dichotomie est voulue par le Dieu Créateur. Il crée la terre par un caillot de son sang (ce qui est une métonymie = partie d'un même ensemble) et les jumelles à son image (ce qui est une métaphore = abstraction de caractères communs) ; en conséquence tout contact avec le créateur est exclu. D'emblée, on relève que la dichotomie combinaison-sélection (ou contigu-similaire) rend impossible le contact du même au même. On reconnaîtra à ces conséquences une portée universelle : - deux êtres semblables ne doivent pas entrer en contiguïté, ni même se rapprocher : ainsi les Jumelles, créées semblables à leur Créateur, en restent éloignés ; - deux êtres devenus semblables doivent s'éloigner (ce qui résume, en particulier, la problématique oedipienne). Ainsi les Katchina quittent les hommes quand ceux-ci purent les imiter. Ainsi, Iatiku (la mère primitive) s'éloigne et laisse une symbolisation d'elle-même, quand les jeunes irrespectueux se moquent d'elle et l'imitent. La seule solution à la proximité est la différence, c'est à dire des configurations physiques (cf. la castration freudienne) ou psychologiques distinctes, annulant la similarité : ainsi les Katchina portent des masques quand ils sont parmi les hommes. Les crises sont le fait de confusions des ordres, engendrées par des anomalies dans l'affectation du réel (naissance de Pishuni, de Koshari) ; ou par le rapprochement de ce qui doit normalement être éloigné parce que possédant des caractéristiques communes préexistantes (Katchina) ou acquises, et cela est extrêmement important. Notons que la transmission de pouvoirs d'un terme supérieur vers le terme inférieur crée entre eux une similarité : toute proximité cesse alors d'être possible, au risque de la crise. La confusion entre métonymie et métaphore oblige le terme supérieur à se retirer. Mais "le terme supérieur en disparaissant laisse toujours plus de lui-même" (Uchtsiti se retirant, laisse aux jumelles le pouvoir de continuer la création ; les Katchina se retirant, laissent aux hommes le pouvoir des masques). Dans tous les cas, une progression générale est faite d'une suite de ruptures dont les caractéristiques communes sont d'annuler une contiguïté préexistante mais il est un prix à payer : perte, abandon, deuil. Il s'ensuit l'acquisition d'un statut nouveau, toujours plus comparable à celui du Créateur. Le Père Créateur se retire après la faute des Jumelles, la Mère Primitive se retire après la faute des moqueurs et de la même manière les Katchina. Ces deuils sont corrélatifs de l'acquisition d'un pouvoir nouveau prélevé sur le terme civilisateur et qui rend plus semblable à lui (père ou mère mythique). Nous pouvons constituer le schéma suivant :  Mais une perte, un deuil ou la mort ne sont pas les conditions exclusives de la légalisation : Elles sont corrélées à trois procès principaux dont nous réservons l'étude : symbolisation, subversion, double... La Genèse occidentale "Plus que le mystère de la Création, c'est le thème du péché originel qui a marqué le monde". Voir iconographie, Musée des arts et traditions populaires. Un des intérêts du travail de Lucien Sébag est de rendre plus transparente à nos yeux la problématique de la Genèse, aux origines de notre propre culture, et de nous donner certaines clés pour la mieux comprendre. La crise, là aussi, est donnée d'emblée comme le produit d'un conflit contigu / similaire. a) Le couple primordial, dans le jardin d'Éden se trouve en contiguïté parfaite avec le Créateur. Il vit dans le même verger, respire le même air. b) Il est fait à l'image du Père, donc en relation apparente de similarité (Nous verrons plus loin comment les théologiens ont reçu cette formule, mais il faut la prendre maintenant au premier degré). c) Mais cette ressemblance s'assortit de différences, importantes, et nécessaires à la coexistence. Nous en relèverons deux : le couple primordial n'a pas la connaissance du bien et du mal, apanage de la nature divine ; il n'a pas de pouvoir créateur. Ces différences (ou ressemblances altérées) sont essentielles en ce sens qu'elles permettent couple la proximité divine dans le jardin de l'Eden : Dieu est les hommes n'ont pas les mêmes pouvoirs (ni le même savoir). La ressemblance est imparfaite et ils peuvent coexister. La crise est explicitement provoquée par la tentation de supprimer ces différences, lorsque le Serpent indique le moyen d'obtenir une similarité plus complète : Vous serez comme des dieux On sait qu'au plan anthropologique, cette invitation s'articule avec un changement du statut culturel : l'abandon - ici l'interdit - de la cueillette et de la collecte passive, c'est à dire, le passage d'un stade paléolithique à l'état néolithique où l'humain devient, lui-même, producteur de sa nourriture. La faute "consommée" enchaîne trois conséquences conformes au schéma donné par Lucien Sébag : - la ressemblance accrue avec le créateur : Adam et Eve deviennent créateurs à leur tour, par le corps et par l'esprit ; ils sont comptables de la discrimination du bien et du mal dont ils ont la connaissance et vont continuer la création (croître et multiplier); - la mise à distance par l'expulsion du Paradis, (la Chute) ; toute proximité est désormais et nécessairement exclue ; - le couple devient mortel ; cette ultime castration des psychanalystes accentue la rupture mais maintient une différence ; en effet une forme de contiguïté persiste entre Dieux et les homme, tous inclus dans le Plérôme (la totalité des êtres) ; cela suppose et impose une altération supplémentaire de la ressemblance : Seuls les dieux sont immortels. L'immortalité de l'homme est clairement donnée comme un danger pour Dieu : Voilà que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous 22 - Alors Yahvé-Dieu dit : "Voilà que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant, qu'il n'aille pas étendre la main, prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais". 23 - Yahvé-Dieu le renvoya donc hors de l'enclos, pour cultiver le sol d'où il avait été pris. 24 - Il chassa l'homme, et, à l'orient de l'enclos d'Eden, campa les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dans ce récit, où la pudeur apparaît comme thème "d'ouverture", il n'est pas difficile de retrouver l'antagonisme contigu / similaire, régulièrement apparu au centre de notre étude. Il paraît alors légitime de rechercher les origines de cette opposition, non seulement dans les régimes de communication entre les humains mais aussi dans les relations avec la réalité toute entière. * * * Cela ne peut que renforcer le questionnement sur le problème de la connaissance, explicitement énoncée, et étroitement connectée à la pudeur. Cette question domine les procédures de transmission du savoir entre les humains (et du pouvoir qui est attaché à ce savoir). Une telle étude ne peut être qu'orientée vers la pédagogie et, à ce titre, mérite un développement particulier dont nous ne pourrons esquisser ici que les grandes lignes. Dans la page suivante nous allons cependant ouvrir quelques perspectives sur ce problème si bien défini dans les mythes culturels, fondamental pour l'humain, qui est la gestion de la ressemblance dans la contiguïté, c'est à dire la coexistence terrestre. 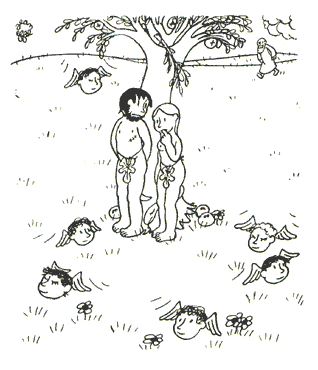
La création du monde selon Jean Effel |
| page précédente ( La pudeur - XII -) page suivant |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |