
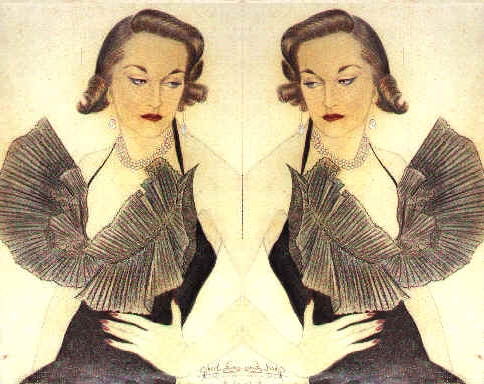 | page
précédente ( La pudeur - XIII -)
page
suivante COEXISTENCE TERRESTRE Survol de problèmes essentiels |
1 - Coexistence 2 - Apprentissages 3 - Assimilation 4 - Père et fils 5 - Pédagogie 1 - Coexistence Nous aborderons cette question par deux exemples qui paraissent éloignés l'un de l'autre et qui reprennent la problématique en cause depuis son expression la plus simple, sinon triviale, pour nous introduire vers des aspects plus complexes. ** Imaginons deux dames invitées à une soirée et constatant qu'elles portent la même toilette ; nul n'ignore le vif désagrément que chacune peut ressentir ; lorsque la mésaventure arriva à deux Dames du Pouvoir, la presse du "Tout Paris" a cru devoir nous transmettre l'incident ainsi que les solutions apportées. Mais point n'est besoin, sur, ce plan, d'être de "Grandes Dames" : voir la même robe portée par la voisine de palier n'est guère plaisant. Le désagrément éprouvé trouve son origine dans la proximité des semblables. Faut-il le redire ? La proximité du même au même n'est pas supportable. On peut se demander si le phénomène n'est pas aussi une composante de la jalousie sexuelle : il n'est pas agréable de se découvrir une identité de rôle vis-à-vis d'un partenaire commun. La distance entre les similaires, ici, est plus que souhaitée. "Je ne veux pas le/la voir", "il fait ce qu'il veut, je ne veux pas le savoir", sont des paroles de sagesse. ** Ce phénomène, qui exclut la ressemblance dans la contiguïté, oblige sans doute des partenaires d'un même sexe à marquer des différences lorsqu'une affection les unit dans la communication érotique. Ainsi, dans les couples homosexuels masculins, l'un des deux adoptera des gestes et attitudes féminisés, de façon parfois outrée, tandis que, pour les femmes, l'une d'elles effacera autant que possible sa féminité. 2 - Apprentissages L'autre exemple concerne le paradis conjugal mais la juxtaposition tire son intérêt du fait que la même problématique transparaît : imaginons qu'un mari veuille apprendre à conduire à son épouse. Dans un ordre donné, l'épreuve va rendre semblables des personnes unies dans la plus étroite contiguïté et nul n'ignore combien la tentative risque d'être tumultueuse. Il faut prendre en compte ceci que mari et femme sont liés par des liens extralinguistiques qui fondent un élément pertinent: le couple. Mari et femme aussi, et pas seulement les couples homosexuels, doivent éviter les espaces de ressemblances s'ils veulent coexister dans une proximité sereine. On peut percevoir que, par cet apprentissage, la transmission du "savoir conduire", de l'un à l'autre, aboutit, dans un ordre donné, à établir entre eux une similarité. Mieux vaut avoir recours au tiers médian : le moniteur d'auto-école. Ainsi les relations de contiguïté et le prélèvement imitatif (apprentissage) ne seront pas concentrées sur la même personne et il y aura dédoublement : la mise en similarité n'empiétera pas sur la contiguïté. 3 - L'assimilation Mais un apprentissage est-il toujours volontaire ? Même si les institutions et les usages permettent aux couples d'éviter de telles occasions de crises, rien n'empêche qu'avec le temps une riche information réciproque s'établisse entre mari et femme. Cette circonstance nous donne une démonstration a contrario du problème exposé. Pas une longue assimilation de l'un à l'autre, mari et femme acquièrent une ressemblance, devenant en quelque sorte frères et soeurs. Pour cette raison précise, ils se trouvent alors moins motivés sexuellement qu'à l'époque où ils se connaissaient moins ou peu. L'intériorisation progressive de la personnalité du conjoint vaut pour une similarité et fait obstacle à la contiguïté, ce qui a pour conséquence un dépérissement de leur vie sexuelle. Ainsi, peut-on rendre compte de la pathologie de bien des couples et des solutions mises en oeuvre, dont la plus connue est le recours à un tiers partenaire, amant ou maîtresse : contiguïté et similarité ne seront pas concentrés sur la même personne. L'échangisme peut trouver ici sa raison d'être et, sous une forme ou une autre, existe dans toutes les cultures. Mais le tiers partenaire réel n'est pas la plus fréquente solution : on sait que le recours aux fantasmes érotiques, alimentés ailleurs que sur le terrain du couple, peut réaliser une alternative au partenaire habituel lequel aura tout à gagner à cette manoeuvre imaginative de son conjoint. Quand aux solutions qui confinent le couple dans une rigoureuse "fidélité" elles se sont imposées dans une histoire encore récente. On les connaît à travers les intégrismes rétrogrades de tous horizons : homme et femmes sont cantonnés dans des fonctions conjugales où se renforcent nécessairement des différences. Généralement l'épouse est fortement subordonnée à son partenaire masculin, seul détenteur du savoir, du pouvoir, du droit de décision. Il est aussi facile de concevoir que l'égalité croissante homme = femme soit actuellement génératrice de davantage de divorces et d'un délaissement du mariage traditionnel. Cela oblige à repenser de nouvelles formes de conjugalité, sauf à retourner aux solutions du passé et à ses monstrueuses aliénations. Que penser aussi des couples pathologiques ? Mari et femme, aussi incapable de se séparer que de vivre sereinement, fonctionnent bien sexuellement. Ils communiquent bien sur ce sujet, mais ils transfèrent dans leur vie quotidienne la négation réciproque ou la crise permanente, petit enfer domestique, rançon de leur félicité érotique. Entendons nous bien, ce n'est pas l'amour qui est en cause mais la situation de couple et la contiguïté nécessaire que contredit fortement des aspects communs dans leur personnalité. N'entend-t-on pas dire : "Ils se ressemblent trop". La sexologie et les thérapies de couple ont beaucoup à apprendre du clivage ontologique. 4 - Père et fils Mais, sous le toit familial, la contiguïté n'est pas que sexuelle et nous verrons que sur le même schéma se fonde toute transmission de connaissances. Dans notre culture certes, les parents n'ont pas pour habitude d'apprendre à lire à leurs enfants, mais le problème est aussi bien repéré dans les cultures primitives qui savent le contourner par le système dit avunculaire : la personne qui éduque un enfant n'est pas le père de famille mais généralement un oncle maternel. Nous pourrions reprendre l'exemple de la conduite auto, non pas entre mari et femme, mais entre père et fils ; là encore l'aventure est risquée car père et fils, tenus à l'amour, sont liés par des liens extralinguistiques de contiguïté qui tissent leurs relations dans l'ensemble familial. Le prélèvement imitatif du fils sur le père ne va pas de soi. Sur un aspect très ponctuel on voit se profiler l'antagonisme oedipien, aux implications infiniment plus vastes : comment devenir semblable au père dans la proximité ? 5 - Pédagogie On voit que, sous le signe de l'antagonisme contigu/similaire (ou combinaison sélection) la question de la Connaissance et de la transmission du savoir, apparaît très directement connectée aux causes génératrices du phénomène pudique. Il advient que des enfants soient victimes d'un curieux effet destructeur du savoir sur leur personne. De tels cas se recensent dans un éventail clinique qui s'étend des dysharmonies évolutives jusqu'à des formes plus légères de dyslexies, ou encore, à diverses formes de refus scolaires. L'enfant est pris dans une contradiction ne lui laissant d'autre choix que risquer la "folie" ou refuser d'apprendre. Quelle est cette contradiction qui place tant d'enfants dans cette alternative redoutable? Le trouble est celui de tout humain devant le processus d'acquisition et d'utilisation du savoir, inséparable d'une identification au tenant de ce savoir. Entrer dans un nouveau schéma d'identification, c'est-à-dire, pour l'enfant, devenir grand, suppose un abandon : celui des relations parentales antérieures. Pour l'enfant, l'accès à la Connaissance ne va pas sans l'abandon d'un certain Paradis dont le prix à payer, nous venons de la voir, est connu depuis longtemps... Ce prix à payer, qui est la rupture d'une certaine contiguïté maternelle, n'est pas acceptable par toutes les personnalités infantiles. Concrètement, dans la plupart des cas, une angoisse de séparation d'avec la mère est mise en concurrence avec l'apprentissage scolaire. Ailleurs on entrevoit la crainte de surpasser le père - ou la mère selon le sexe - ou tout simplement de les égaler, ce qui, nous le savons, veut dire les perdre d'une certaine manière, en tous cas accepter cette transformation des relations qu'impose la ressemblance accrue. L'antagonisme que l'on perçoit entre apprentissage et l'attachement parental affecte ces deux modes relationnels fondamentaux que sont le rapport de proximité - celui des relations affectives - et le rapport d'imitation qui annonce un remaniement critique des relations préexistantes. Tel enfant freinera des quatre fers devant le savoir ou s'acharnera d'abord à dénaturer l'écriture - et l'orthographe - comme nous l'avons tous fait pour la parole dans la période du "parler nounou" et pour des raisons comparables : ne par parler ou écrire comme papa et maman. Ou encore il recommencera inlassablement au point de départ pour s'assurer que l'apprentissage : a) ne transformera rien, b) et que se maintiendra indéfiniment le lien établi. Nous sommes à l'opposé des buts de l'enseignement. Un enfant dans cette situation souffre intensément de l'école. Il se défendra "bec et ongles" du savoir qu'elle veut lui apporter et ne cultivera rien en lui. Faut-il baisser les bras ? Non car la connaissance du processus nous indique les chemins à suivre : Les cas les plus démonstratifs entrent dans la catégorie des états dysharmoniques qui, on le sait, laissent apparaître un certain risque d'évolution vers la psychose adulte, dont ils préfigurent l'organisation. Le problème est d'autant plus important qu'une pédagogie spécifique, non seulement permet des acquisitions nécessaires à la socialisation, mais encore et surtout paraît constituer le meilleur recours thérapeutique. Le point essentiel est de contourner le refus de ces enfants d'évoluer intellectuellement dans l'abstraction qui est l'absolu de la métaphore. La méthode à mettre en oeuvre doit éviter, et de façon plus ou moins durable, toute conjonction du sens et du code (qui n'est qu'imitatif). Il faut donc s'attacher à conduire un apprentissage tout en dissociant continuellement ces deux éléments, code et sens. Ceci veut dire qu'il convient enseigner en premier les instruments, les techniques de l'écriture et de la lecture, les lettres avec la manière de les combiner phonétiquement, sans prendre appui sur la signification. Ce n'est qu'ensuite, ceci étant acquis que l'on peut passer à l'application dans des formes écrites pourvues d'un sens (les mots). Nous sommes donc à l'opposé des méthodes dites globales où l'on part du sens pour faire connaître et reconnaître l'écrit correspondant et au-delà, l'alphabet et le syllabaire. Le défi n'est pas insurmontable puisqu'une telle méthode fut longtemps la seule pédagogie existante. Elle a donné ses preuves chez les Anciens, dans l'Education Antique. Chez les jeunes grecs, le syllabaire devait être acquis et maîtrisé avant que la composition des syllabes ne serve à la reconnaissance d'un sens et ne soit utilisé à des fins signifiantes. L'enfant devait travailler sur des séquences de syllabes plus ou moins longues et totalement dépourvues de signification, ce qui évidemment nous paraît rébarbatif. Avant de les assembler dans des mots intelligibles, l'écolier devait se familiariser avec toutes les compositions syllabiques possibles utilisées dans la langue, les reconnaître, les associer dans les copies et les dictées de sons, éloignées de tout sens. Ce n'est que dans un temps second, étant maîtrisée la transposition écrite des sons, que l'enfant entrait dans la phase d'application au vocabulaire réel, pour la lecture et pour l'écriture. A notre époque, la mise en application n'est pas impossible et permet d'en vérifier rapidement le bien fondé. Elle fut réalisée dans une école à laquelle nous avons consacré une part de nos activités pendant plusieurs années. (On trouvera ici ou là des développements et prolongements de ce texte). 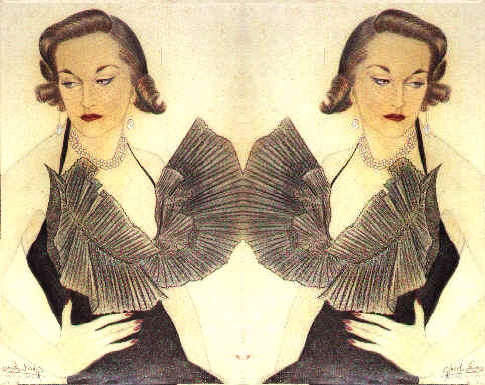 |
| page
précédente ( La pudeur - XIII -)
page
suivante |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |