
 | FONCTIONS EXCREMENTIELLES, CONDUITES ALIMENTAIRES (english) |
1) Inconvenances du corps 2) Ce qui ne se dit pas ne se montre pas 3) Les parties honteuses 4) Le besoin de l'autre... 5) Les consommations hors protocole 6) Un exemple de pulsion mise à nu Le phénomène de la pudeur est-il interrogé comme il le mériterait ? Ne peut-on espérer voir s'ouvrir ici un plan épistémologique nouveau conduisant à réfléchir sur ces rapports du corps et de l'âme qui fondent la philosophie occidentale depuis quelques siècles ? Quant à la morale qui en est issue, et qui cultive l'interdit, elle se soutient de ce "blanc" dans le savoir dont nous parlions et que la science devrait avoir vocation de refuser. Plus concrètement remarquons que les sciences humaines s'aventurent prudemment sur le lieu de la pudeur. En celle-ci interfèrent étroitement notre présence corporelle, nos réactions émotives, et par le biais de notre langage, l'ensemble des rapports entre l'être et la personne. En effet, si le discours est influencé par la pudeur, le corps en ressent également des effets totalitaires. L'emprise émotive qui les exprime a, son nom l'indique, quelque parenté avec la peur. Nous nous sommes attachés à montrer que cette double action inhibante, cette double sensibilité, du corps et de l'âme, et cette double expression, psychique et physique surviennent toujours sur le lieu d'une communication entre les personnes dès l'instant que certaines "lois de nature" affrontent la toute puissance du symbolique. Mais les "lois de nature" ne concernent pas que la sexualité et nul ne peut ignorer que d'autres fonctions humaines sont assujetties à la même contrainte. Pour certaines, le phénomène saute aux yeux. Il est pour d'autres moins visible, moins reconnu, ayant, dans tous les cas, une incidence certaine sur les échanges interpersonnels et sur la configuration socioculturelle des personnes et des communautés. Les cocasseries du corps Dans ce recensement laisserons-nous de côté l'éternuement, la toux, le hoquet ou autres borborygmes ? Toutes ces "cocasseries du corps" (La pudeur, Ed Autrement, sous la direction de C. Habib) peuvent provoquer une gène. Occasion pour nous de remarquer que les paroles rituelles : " à vos souhaits", "Dieu vous bénisse" sont de longue date réservée à l'éternuement. Par contre il convient souvent de conjurer par quelques mots plaisants un grondement intestinal un peu bruyant, un hoquet inopportun, l'irruption d'un besoin pressant. Des fonctions excrémentielles il est malséant de parler. C'est cependant une des autorités de la psychanalyse, George Groddeck, qui nous fait savoir, dans le livre du Ça, que : "la femme la plus distinguée pète". Difficile cependant, sur ce sujet, d'enjoliver notre texte par des références littéraire. Seule la folie du Président Schreber lui a fait écrire : "Comme tout ce qui arrive dans mon corps, le besoin de déféquer est lui aussi provoqué par des miracles; cela consiste à pousser l'étron en avant (bien souvent il est repoussé vers l'arrière), et lorsque, par suite de l'exonération, il n'y a plus de matières en suffisance, on vient barbouiller mon orifice postérieur avec le reste du contenu des boyaux"... Mais le Président Schreber parle au nom de la science, et même du Savoir Universel. Preuve de la perfidie qui est poursuivie a son encontre : "A chaque ... besoin de déféquer, on expédie quelqu'un de mon entourage au cabinet" ... "Quand alors, sous la pression d'un besoin, je décharge réellement--je me sers presque toujours d'un seau pour le faire, puisque je trouve le cabinet presque constamment occupé -- ... chaque fois .... La délivrance de la pression causée dans le gros intestin par les excréments a notamment pour conséquence un bien-être intense procuré aux nerfs de volupté"... 
Jérôme Bosch, extraits de l'"Enfer". On peut aussi faire le fou et cultiver un aimable exhibitionnisme comme Salvador Dali. Toutefois, le Maître Catalan, à son insu, recours à certains mécanismes importants à connaître de la réserve pudique: la distance temporelle et le discours cité. Ils indiquent, résistant à la provocation de l'auteur, une soumission persistante à la pudeur verbale. "Comme d'habitude, un quart d'heure après le petit déjeuner, je glisse une fleur de jasmin derrière mon oreille et vais au privé. A peine suis-je assis que je fais une selle presque sans odeur. Et cela, à un tel point que le papier hygiénique parfumé et mon brin de jasmin dominent complètement la situation. Cet événement aurait pu être prédit par les rêves béatifiaient et extrêmement plaisants de la nuit qui, chez moi, annoncent des défécation suaves et inodores. La selle d'aujourd'hui est de toutes la plus pure si cet adjectif est toutefois propre à être employé dans une telle occasion. Je l'attribue sans conteste à mon ascétisme quasi absolu et me souviens avec répugnance et presque horreur de mes selles à l'époque de mes débauches madrilènes avec Lorca et Buñuel quand j'avais vingt ans. C'était de l'innommable ignominie pestilentielle, discontinue, spasmodique, éclaboussante"... Faut-il rappeler ici que le message olfactif est quasiment universel chez le vivant? Notons donc que devant ce mode de communication, si peu traduisible par les mots, Dali par une euphémisation ludique transforme l'odeur dans le sens de la suavité - comme il transforme la sonorité dans le sens de l'euphonie en commentant ce "pet très long, vraiment très long et ...mélodieux". Il en est constamment ainsi dans le présent du récit : "ma selle était ... ce matin, fluide et inodorante". S'il parvient, plus loin, à évoquer l'odeur sui generis ce ne peut être que par le biais de la distance temporelle ("quand j'avais vingt ans"...). Nous retrouverons cette solution de mise à distance dans les réaction pudiques de la sexualité ou de l'alcoolisme ("quand on est jeune"..., "autrefois"...). |
| La
distance temporelle : Cette image serait inconvenante et incongrue si l'on n'apprenait qu'il s'agit d'un excrément fossile daté de 120 millions d'années). |  |
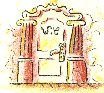 | Globalement, l’occultation
matérielle résout
cet impératif ; elle est bien codifiée dans
l'architecture urbaine ou campagnarde des lieux
appropriés. Illustrations de Serge Bloch in "Les
cabinets" ed. Casterman 1993. |  |
 J.-B. Chardin, Le Bénédicité (détail) | C'est ainsi qu'il faut entendre la force contraignante des manières de table et des règles de préparation des aliments, dont la portée symbolique et la force structurante ont été mises en évidence par les travaux de l’école de Lévi-Strauss. On est donc fondé à récuser une position qui conduirait à admettre que, à la différence du besoin sexuel, "social et socialisé dans son essence, (parce qu'il a besoin de l'autre)"... les "médiations sociales ne sont jamais fondamentales pour d'autres fonctions biologiques comme le boire et le manger". (L. Sève) |
| Si pour l'acte naturel de manger, l'être
civilisé a essentiellement besoin de l'autre, il demeure que
pour plupart des personnes, les contraintes sur le langage n'y sont
pas apparentes. Il est à cela une raison : la transformation préalable des
aliments, leur "conditionnement", associés aux manières
de table, évitent par anticipation, dans tous les cas
"civilisés", tout risque de conflit entre le protocole social
et un acte corporel qui exprimerait la pulsion pure. Dans tous les cas, sauf dans les
dérégulations individuelles que sont la boulimie et
l'alcoolisme. Ces deux affections, qui imposent au sujet une
consommation hors
protocole, le conduisent du même coup
dans les rivages de l'indicible, introduisant dans son discours une
large gamme de coupures et de déformations. L'alcoolisme : un exemple de pulsion mise à nu Ces coupures et déformation font de la maladie alcoolique un observatoire privilégié des phénomènes de langage et des procédures de l'énonciation. C'est donc à travers cette affection que, plus loin, nous étudierons le détail des mécanismes d'inhibition qui sont ceux de la pudeur, leur fonctionnement et les solutions qui leurs sont appliquées. Signalées depuis toujours, ces perturbations sont encore trop souvent imputées à une supposée "mauvaise foi" ou, rapportées à la notion psychanalytique de dénégation (malgré les difficultés théoriques et cliniques d'un tel rapprochement). L'irruption de la réserve pudique dans les conduites alcooliques tient à ceci que le patient se voit contraint par sa dépendance à un usage détourné du protocole social. Conformément à ce qui a été dit plus haut pour les aliments en général, la prise de boisson, acte de nature sans lequel nul être serait vivant, s'exécute, chez l'homme en société, sous le signe du geste culturel. On boit pour accueillir, commémorer, "accompagner un repas". On trinque pour conclure une belote, mais la personne dépendante, qui rejoint ses camarades au bistrot, ne partage avec ceux-ci aucun de ces motifs légalisateurs. Seule existe et prévaut en elle l’opportunité, bienvenue ou recherchée, de satisfaire à son besoin d'alcool. Il y a usage détourné du rituel social, et autour de ce détournement, se joue la question du langage : pour notre patient certains gestes présentatifs (et représentatifs) qui sont ceux de la communauté n'accomplissent plus leur fonction signifiante. Le rapport apparent est inauthentique et les composants normaux du signe linguistique, le signifié et le signifiant, ne renvoient plus à un même référent. Disons qu'il n'est plus de rapport de signifié à signifiant entre le protocole social et l'acte de boire. L'inadéquation du signifiant enraye le fonctionnement normal de l'énonciation. Par un autre biais nous retrouvons ces contraintes qui empêchent chacun d'énoncer, les faits du sexe : au plan des conduites alimentaires, le patient ne peut davantage dire le détail, quand, comment, combien et en quelle circonstance il a consommé. Dans le premier cas nous sommes dans un processus non symbolisable. Dans le second cas, nous sommes devant une démesure qui outrepasse le protocole constitué par le consensus communautaire. Guidée par une "pulsion mise à nu", cette conduite est rebelle à l'inscription symbolique. Là encore, ce qui ne peut se dire ne peut se laisser voir. En cette matière une telle contrainte peut surprendre, mais elle étonne d'abord l'alcoolique lui-même lorsqu'il boit en cachette. Madame R. réfléchit, après son sevrage à la honte permanente qui l'habitait au temps où elle buvait : "Ce qui m'étonne c'est que je me cachais même chez moi où pourtant j'étais seule." - "Je ne cachais pas les bouteilles dans les placards du salon,... parce que dans cette pièce il y avait des photos de ma famille et un Christ sur un crucifix... c'est comme s'ils avaient des yeux." - "Cela m'intriguait que, étant seule, je cache la boisson sous les matelas, dans ma chambre, parce que dans ma chambre il n'y avait ni photos ni Christ." - "Je n'avais pas le courage de me servir un verre ou de laisser la bouteille sur la table dans le salon". "Personne ne m'aurait vu, mais il y avait ces photos et ce Christ...." - "J'allais boire au goulot en me baissant sous le matelas, comme si là ils ne me voyaient pas". En ce domaine, l'étude du fonctionnement pudique devient affaire de spécialiste, bien plus que pour la vie sexuelle. Mais sous un autre aspect, et pour d'évidentes raisons, l'observation objective va s'avérer d'un meilleur maniement, plus facile à saisir, à analyser et à exposer. |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |