
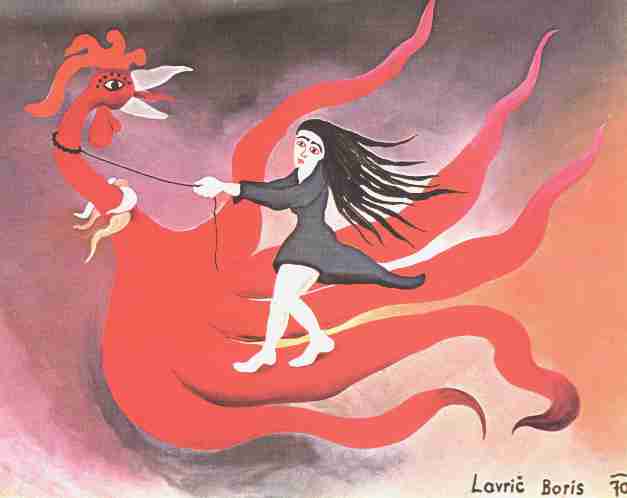 | Comprendre l'alcoolisme PROVISIONS ET CACHETTES Texte développé (3379 mots), vers le texte abrégé D'après J. et M. Morenon "Provisions et cachettes" JOURNAL D'ALCOOLOGIE, 17 rue Margueritte 75017 PARIS. |
1 une attitude typique de l'alcoolique 2 réserves dissimulées et réflexe de survie 3 la puissance du rituel convivial 4 alibis et lieux permissifs 5 la solitude et l'acte clandestin La constitution et la dissimulation de réserves, "et plutôt trop que pas assez" sont une attitude typique de l'alcoolique. Ce comportement ne paraît pas sans rapport avec les stratégies de survie observées dans les pénuries alimentaires et doit être examiné sous ce jour avec le patient. La prise d'alcool solitaire, toujours culpabilisée, est un effet de la dépendance qui contraint le sujet à déroger aux rituels de consommation. Elle met en relief l'extrême importance de ces rituels, assimilables aux manières de table, et dont la puissance signifiante peut éclairer certains traits sémiologiques de l'alcoolisme. "Une attitude typique de l'alcoolique" La carrière professionnelle de Monsieur B. s'annonçait bien, mais les promotions furent régulièrement suivies de rétrogradations devant l'accumulation de fautes professionnelles et la répétition des ivresses. Il fut licencié après plusieurs tentatives thérapeutiques. L'alcoolisme avait commencé après le mariage. L'épouse a parlé de divorce, ce qui a provoqué une première cure. Par la suite elle change d'attitude et fait preuve d'une tolérance croissante vis à vis de l'alcoolisme du conjoint. L'abstinence enfin acquise, Monsieur B. parvint à rétablir sa situation professionnelle, mais sur le plan du couple les relations restent distantes. Dans la période qui suivit l'hospitalisation il se préoccupa de se débarrasser des bouteilles vides ou pleines qu'il avait cachées à son domicile. "Il y en avait partout", disait-il, surtout enterrée dans le jardin, là même où le chien de la maison enterrait ses os. La question que pose cette trop banale observation est de savoir pourquoi Monsieur B. éprouvait la nécessité d'accumuler des provisions d'alcool, de les dissimuler et de les boire en cachette alors que son épouse, sans avoir réellement "baissé les bras", n'intervenait jamais directement et avait cessé d'être restrictive. Pourquoi constituer des provisions et cacher les bouteilles alors qu'il n'avait ni privation ni censure à redouter ? On le sait, ce comportement est d'une grande fréquence chez les alcooliques. Tout comme les quantités consommées, le fait est soigneusement dissimulé par le patient dans les premiers entretiens. Il n'est commenté qu'après un certain temps de sevrage. La constitution de réserves clandestines "...plutôt trop que pas assez" est, comme le soulignait une patiente, "une attitude typique de l'alcoolique". Elle peut devenir une préoccupation permanente, de chaque jour et de chaque heure, et revêtir le caractère d'une véritable obsession. A vrai dire ce symptôme, quasi-universel dans l'alcoolo dépendance, interpelle peu les chercheurs pour la raison probable que, dans son apparence immédiate, il répond à utilité dont l'évidence saute aux yeux : - le patient se préoccupe de pouvoir boire quand le besoin est là et le sollicite ; il s'assure une provision immédiatement accessible et en quantité suffisante ; - la réprobation que suscite son alcoolisme, souvent à ses propres yeux, l'incite à soustraire au regard d'autrui cette réserve à usage très personnel. Pourquoi donc s'attacher à ce problème? * En premier lieu parce que la réalité nous paraît bien plus complexe. Là où, à rebours de l'ordre social ou familial, le patient organise sa "survie alcoolique", se profilent des motivations plus profondément enracinées dans la biologie de notre espèce, et même de toutes les espèces. * En second lieu parce qu'il renferme pour le patient un élément important de culpabilité, ce qui constitue, de nos jours, le point faible de la relation clinique en alcoologie. Que les motivations dont nous parlons ne soient en rien spécifiques de l'alcoolisme est un fait important à connaître et à traduire au patient. Lorsque celui-ci acquiert une meilleure connaissance des bases de son comportement, il apprend quelque chose sur lui-même. Ce "quelque chose", ne s'inscrit pas directement dans les malédictions de l'alcoolo dépendance, et par là, favorise la possibilité d'ouvrir une parole sur une attitude psychique qui est à plus d'un titre reconnue comme "honteuse". Réserves dissimulées et réflexes de survie Car cette constitution de réserves dissimulées n'est pas sans analogies avec les habitudes ordinaires de nombreux êtres vivants. Elle paraît empruntée à des réflexes biologiques de survie. Le chien dont nous parlions n'accumulait-il pas des os et, comme ses congénères, n'enterrait-il pas, pour le dissimuler, ce "trésor" que d'autres pouvaient lui disputer? Pour nos patients en état de dépendance, on peut pressentir qu'une attitude préventive du manque est élémentaire. Mais pour la mieux comprendre chez l'humain il faut se référer aux périodes de restrictions ou de disette afin d'en repérer le processus et d'aider le malade à se repérer dans sa conduite. Chacun sait que durant ces périodes, il est vrai peu actuelles dans nos pays et à notre époque, la constitution de provisions et de réserves est une préoccupation des individus comme des communautés. Là où les responsables essaient de prévenir l'éventualité d'une famine, les groupes familiaux agissent de même et, s'ils le peuvent, constituent des réserves. Parfois, au sein de la famille, les individus agissent ainsi pour leur propre compte, mais c'est au risque de la honte qu'ils rompent le cercle de la solidarité. Les autorités protègent ces réserves dont elles font connaître l'existence pour rassurer les populations. Le comportement est inverse dans les groupes plus restreints, familles et personnes particulières : leur tendance constante est justement à la discrétion et à la cachette. Constituer un stock alimentaire, dans la perspective redoutée d'un manque plus ou moins durable, est un réflexe qui ressurgit parfois de façon irrationnelle et inattendue, dès que se profilent sur la scène internationale des événements à l'issue incertaine. Mais à ce réflexe, au demeurant bien ajusté s'ajoute cette règle quasi-absolue et bien compréhensible de ne rien divulguer, de ne pas "crier sur les toits" que l'on a pour les siens, ou pour soi-même, accumulé des provisions. Pour nos patients, étant évidente la permanence d'un besoin jamais satisfait, tout laisse penser que cela ne saurait aller sans l'inquiétude d'une pénurie toujours menaçante. Car à cet égard, le problème est le même qu'il s'agisse d'un approvisionnement insuffisant ou d'une demande toujours amplifiée. Nous pourrions nous satisfaire de cette analogie ; deux hypothèses sensiblement opposées peuvent alors rendre compte d'une incitation permanente à consommer. 1- Soit l'exaspération du signal d'appétence, notion sur laquelle est installée la quasi-totalité des théories pathogéniques. La compulsion se confond avec la quête d'un plaisir pour lequel le patient révoque les formes et les normes qui structurent sa vie. Sous ce jour la constitution de réserves cachées représente l'effet du désir et l'anticipation d'un plaisir égoïste. La culpabilité est inscrite dans l'acte. 2- Mais il semble que chez l'alcoolique "le besoin prime sur le désir" et, pour la majorité des cas, nous donnerons notre préférence à l'hypothèse d'un défaut de satiété, ce qui est plus qu'une nuance. En effet, la pratique universelle de l'abstention thérapeutique d'une part, son efficacité d'autre part, n'indiquent pas l'intensification d'une demande mais la non apparition de l'arrêt instinctif après la mise en appétit par le produit lui-même. Ceci est tout autre chose et surtout a l'avantage d'être entendu du patient qui y reconnaît le processus de sa défaillance. On peut faire réfléchir sur ce point le consultant qui nous confie : "quand je commence, je ne peux plus m'arrêter". Il nous dit ici l'essentiel sur sa dépendance ressentie comme un besoin accentué et entretenu sans recours par la substance elle-même lorsqu'elle est ingérée. La relation est alors facile à suggérer entre la permanence de ce besoin et les craintes de pénurie alimentaire, entre son intensité et l'anticipation constamment révisée à la hausse de la quantité susceptible de le satisfaire. Le même phénomène existe chez les boulimiques et le rappel d'un comportement d'accumulation, aussi élémentaire dans la biologie des êtres, permet au patient de se reconnaître dans ses actes en dehors d'un contexte de pure dépendance alcoolique. L'analogie est d'ailleurs vite saisie par le malade et volontiers commentée par lui. Elle entraîne souvent un acquiescement significatif, l'accompagnateur présent pouvant être surpris autant par ce moment de vérité inattendue que par la révélation d'une habitude que, parfois, il ne soupçonnait pas. La puissance du rituel convivial Si la constitution de réserves et leur dissimulation s'explique par une crainte de pénurie biologiquement liée à la permanence du besoin, le même motif ne rend pas compte directement de la culpabilité attenante, ce qui constitue la deuxième face du problème. En effet à la différence des personnes en période de pénurie alimentaire, l'alcoolique qui fait des provisions n'agit pas au détriment d'autrui et ne prive pas directement ses semblables. La transgression n'est pas du même ordre au plan moral. Mais il boit seul, en cachette et on notera combien ce geste le place à l'opposé de l'amateur de bon vin qui prendra au contraire du plaisir à faire visiter une cave bien garnie et à proposer la dégustation de ses meilleures bouteilles. Etant dissimulé, le geste solitaire de prise d'alcool paraît témoigner d'un sentiment fautif. Chacun sait qu'il a un caractère péjoratif : l'alcool est une boisson sociale. C'est un usage bien établi et universel de ne pas boire sans faire partager, sans prendre à témoin la collectivité. Les rituels de consommation sont un langage et une syntaxe au même titre que les manières de table ; l'acte corporel ne suffit pas à l'acte de boire. L'acte de nature n'a plus cours pour l'homme en société. Celui-ci tire sa subsistance de l'action communautaire, du savoir collectif, du rapport à autrui et non d'un geste individuel de cueillette que les Ecritures nous disent prohibé dès les origines. Chez l'être véritablement humain, tout acte corporel est pourvu d'un sens qui est mémorialisé dans les fondements de notre culture. La continuité est sans faille entre le moment Eucharistique du partage du Pain et du Vin et la tournée qui intègre le nouveau venu sur le chantier ou à l'usine. Ce geste renouvelé chaque jour témoigne de la solidarité de chacun dans l'équipe ouvrière, comme dans une communauté de fidèles. On trinque pour commémorer, célébrer, fêter, accueillir voire apprécier, témoigner, juger, "accompagner un repas". Il existe une spécification particulière et très précise selon les moments, les lieux et le contexte. On ne boit pas la même chose le matin, l'après-midi et le soir, avant ou après le repas, selon les mets, selon les convives et leur milieu social. En fait c'est par des liens symboliques très forts, que la communauté de production a son reflet constant dans la communauté de consommation. Dans les actions les plus archaïques de chasse ou de pêche, l'acte collectif est suivi d'une répartition collective et hiérarchisée de la nourriture ainsi acquise, sans oublier les Dieux, et cela dans les plus primitives des cultures. Une consommation normale de boissons alcoolisées s'inscrit dans une prescription sociale et culturelle représentative du travail des hommes en société et de leurs règles de coexistence. Lévi-Strauss, dans l'ouvrage qu'il y consacre rend compte du caractère universel des manières de table, gestes symboliques de convivialité qui valent pour un langage. Les rituels de consommation, sont des énoncés préexistants à l'acte de boire, des règles congruentes à la substance linguistique qui du même coup légalisent l'acte corporel toujours incestueux. La finalité corporelle de l'acte de boire est détournée au profit d'une signification dans un code de comportement convenu et convenable qui assure à l'acte de nature, un ancrage dans le symbole. Voilà par quoi et pourquoi le consommateur ordinaire peut énoncer sa consommation. Pour le boire comme pour le manger, il peut le faire dans les limites d'une norme sensiblement équivalente, codifiée et définie selon les individus et parfois dans une catégorie sociale donnée. Les tournées traditionnelles assurent finalement un décompte des quantités auxquelles chacun peut prétendre. Alibis et lieux permissifs On conçoit que le respect de cette norme soit le problème majeur du sujet dépendant. Son dépassement constitue en lui-même une transgression à partir du moment où ses besoins ne sont plus concordants avec les lieux, les moments, les rites et les contextes réguliers de consommation. Dans la dépendance ordinaire, la prise d'alcool solitaire ne témoigne pas d'autre chose que d'une demande corporelle. A ce titre elle est occultée par un authentique phénomène de pudeur. Car il n'est pas facile à l'alcoolique, qui est une personnalité développée, de se soustraire à la puissance du signifiant. Cet assujettissement se traduit par deux types de comportements qui précèdent en général le temps de la consommation clandestine. Dans la première période de son intoxication le patient tentera de dissimuler sa stratégie d'approvisionnement derrière des actions légitimes, le bistrot, les copains, le tiercé, le travail achevé, la partie de carte ou de boules. On sait que ces validations rituelles ne sont qu'apparences: le tiercé, les cartes ou les boules, perdent leur intérêt et ne sont plus des motifs pour eux-mêmes ; ils ne représentent qu'autant d'occasions de consommer. Cette utilisation détournée des rites sociaux, si courante en clinique, est efficacement opposée aux proches. Chacun connaît ces itinéraires qui, quotidiennement, du matin jusqu'au soir, à travers les actions les plus banales devenues des alibis, placent la journée de l'alcoolique sous le signe de son obsession secrète : la recherche toujours renouvelée d'une occasion de boire. Les formes et des normes du groupe sont ici préservées dans les apparences et c'est dans une intoxication plus avancée que cette utilisation inversée des motifs conviviaux cède la place à la consommation clandestine. Toujours sous la pression du signifiant, pourrait-on dire, une autre stratégie consiste à rechercher des lieux, des moments, des contextes sociaux où le dépassement, nécessaire au patient, est en quelque sorte légalisé, lieux de beuverie, que redoutent les proches ou les conjoints du sujet, mais où l'interpsychologie collective légitime la démesure. Au fur et à mesure que s'intensifie la dépendance le côtoiement d'autres buveurs devient, pour cette raison, davantage nécessaire. On sait que l'alcoolisme nivelle les affinités sociales et culturelles au profit de la communauté du boire. Les fréquentations de l'alcoolique tendent à se réduire à celles d'autres alcooliques, au moment où ils boivent, indépendamment de toute autre considération et jusqu'à la clochardisation. Il faut retenir cependant que ce comportement indique la nécessité de maintenir, malgré tout, un support symbolique et un accompagnement à l'acte de boire qui finalement accapare la vie. Sous cette forme, la validation légitime est des plus rudimentaires. Elle se résume souvent au double accompagnateur surtout chez les femmes qui fréquentent moins facilement les lieux publics de consommation et boivent plus facilement chez elles avec une amie. Chacun, homme ou femme, s'adresse à la forme de validation qui est en cohérence avec son identité propre et lui convient. Voilà ce qui donne l'apparence d'un alcoolisme masculin distinct d'un alcoolisme féminin. La solitude et l'acte clandestin L'absence de motif même détourné, le dépouillement de tout signifiant renvoie à l'acte impossible sur la scène sociale. L'homme est par nature un être de culture et il est donc dans sa nature de ne pouvoir aborder pour lui-même l'acte corporel dans ce qu'il contient du réel et de réel. Lorsque cela n'est plus contournable, lorsque l'obéissance au corps est requise, dans la vie sexuelle comme dans l'alcoolisme, c'est le silence et le secret de l'acte qui s'imposent, un secret particulier et que chacun connaît et qui chez l'alcoolique est contenu dans cette phrase: "je sais que vous savez". Mais, au risque de la honte, cela ne peut se dire ou se laisser voir. * * * Cachettes, provisions, prises d'alcool clandestines, sont des processus que la clinique relie, qui s'enchaînent, mais qui sont orientés chez l'humain par des données sensiblement distinctes de la psychophysiologie. Ils ont en commun d'être provoqués par la continuité du besoin d'alcool mais ne se présentent pas comme des réponses qui seraient spécifiques de cette toxicomanie. - La constitution de réserve peut obéir à des facteurs externes (disette) aussi bien qu'internes (boulimie) qui ne sont pas l'alcoolisme. - La consommation clandestine est d'une autre nature mais se rencontre aussi dans les deux cas que nous avons cités de la disette et de la boulimie. Plus profondément elle rejoint l'effacement de l'acte corporel qui, faute d'accompagnement symbolique doit être soustrait à la scène sociale, comme la sexualité l'est pas la pudeur : ce qui ne peut se dire ne peut se montrer. 
|
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |