
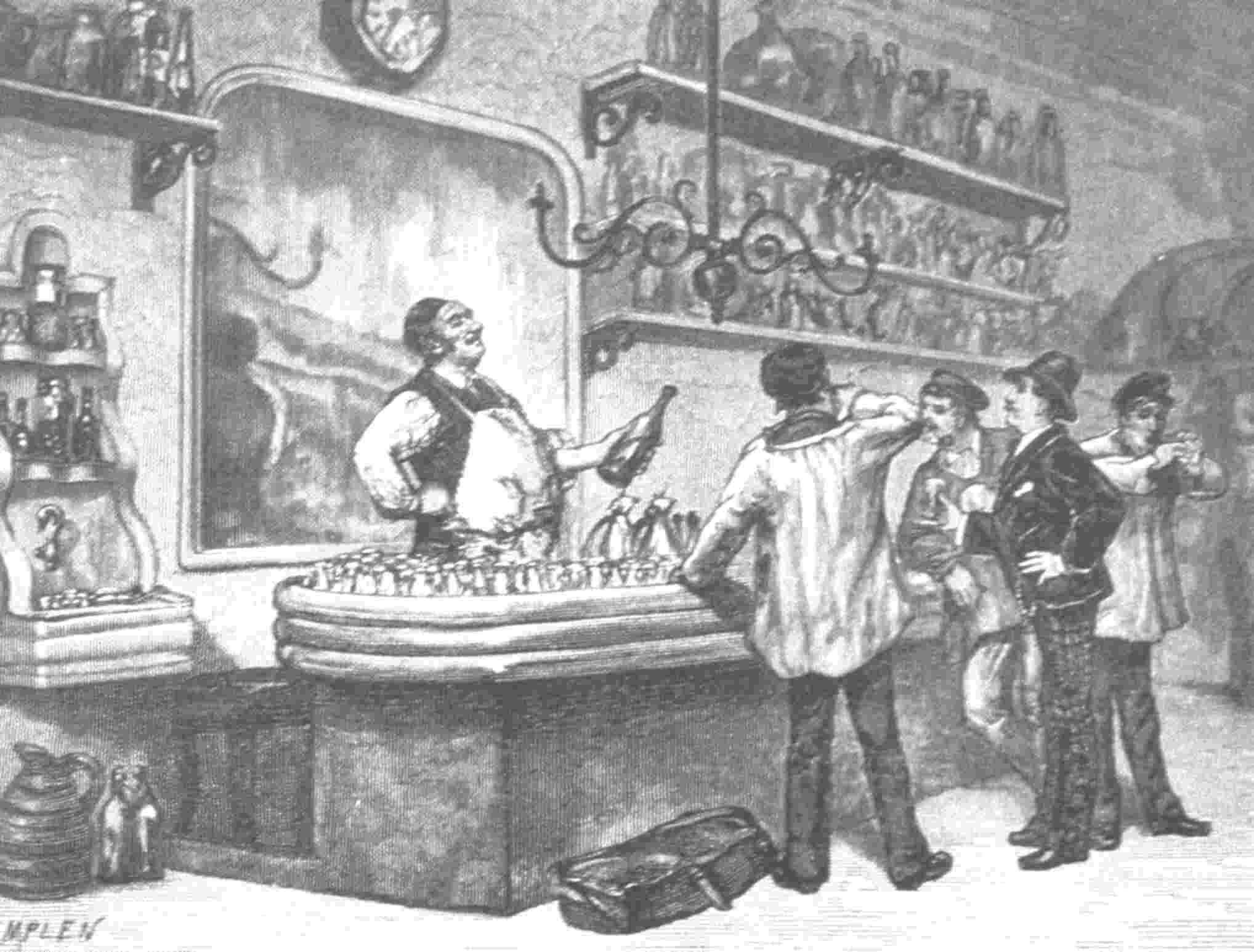 |
|
| Des troubles de l'expression verbale affectent la relation de l'alcoolique tant avec l'entourage qu'avec le médecin, aussi longtemps que dure l’intoxication. Ils disparaissent avec l'abstinence et sont sans rapports avec des problèmes de personnalité. Il demeure que ces perturbations troublent gravement les relations familiales et la relation médicale. Nous estimons qu'ils contribuent très largement à l'aggravation de cette affection ne serait-ce qu'en retardant l'acceptation des soins. Nous leur avons consacré une série d'articles, les plus récents avec la collaboration de François Péréa, Docteur en sciences du langage. |
|
|
| L'alcoolique parle, mais ses proches se
lassent de ses discours trompeurs et ses médecins
connaissent d'avance ses dérobades qui forment autant
d'obstacles à une relation de confiance. Cette
réalité a motivé de nombreuses recherches sur
son langage mais qui, jusqu'ici, ont toujours été
conduites dans un cadre médical. Autant dire qu'elles ont
toujours interprété des paroles
contrôlées. Pour contourner cet inconvénient
nous avons porté l'étude sur des conversations de
comptoir, assurément plus spontanées qu'en cabinet
médical. |
| Nos documents ont été
recueillis dans quatre établissements par des
enregistrements audio discrets et anonymes. Sans être en
état d’ivresse, les consommateurs, objets de
l'enquête, étaient cependant sous alcool, buvant
de manière régulière et excessive.
L'intervenant, spécialiste en sciences du langage, a
laissé se dérouler les discussions des clients
sans les orienter. L'enquête visait à étudier :
|
Toutes nos conversations ont leurs lois,
dans la répartition des tours de parole et le choix des
sujets ; le rôle du parleur est ordinairement tenu
successivement par les différents participants. Ce
déroulement est-il respecté par les alcooliques ?
Difficilement, et deux attitudes apparaissent selon:
Les conversations mixtes on y observe deux profils : (1) Le premier montre que l'alcoolique accapare à la fois le temps et le sujet de discussion. Voici le partage du volume de parole entre l'alcoolique (H), la serveuse (P) et l'enquêteur (F) |
|
|
| |
|
H ("alcoolique") |
(91,7 %} |
(49,15 %); |
|
P ("non alcoolique") |
(6 %) |
(32,95 %) |
|
F ("non alcoolique") |
(2,3 %) |
(17,9 %) |
|
Total |
(100%) |
(100%) |
| H (alc.) prononce 91,7% des mots et accapare 50 %
des tours de parole. La monopolisation de la parole va de pair avec une monopolisation des sujets de discussion. L'alcoolique tend à ne parler que de lui et impose plus de thèmes. Les participations des non alcooliques sont écourtées, sauf lorsqu'elles permettent à l'alcoolique de satisfaire son égocentrisme. Si l'interlocuteur développe ses sujets personnels, l'alcoolique ne s'y intéresse pas. (2) second profil : quand l'interlocuteur résiste, les volumes de parole s'équilibrent. Puis lorsque le partenaire parle de lui-même ou d'un sujet "neutre", la participation de l'alcoolique diminue ; elle ne redevient importante que s'il trouve l'occasion de se raconter. L'alcoolique ne sait pas écouter un interlocuteur dont la parole est trop personnelle ou singulière. Ainsi, dans cette conversation entre N et l'enquêteur F : |
|
|
|
|
|
Future paternité de F |
|
|
|
les filles de N |
|
|
|
Mariage de N |
|
|
|
Mère de N |
|
|
|
L'argent gaspillé des ménages |
|
|
|
Jeunesse de N |
|
|
|
Exemple donné par F |
|
|
|
Coupe du monde de football |
|
|
| Dans les conversations entre alcooliques
les choses sont différentes selon que les alcooliques se
connaissent ou non. (1) S'ils font connaissance il y a lutte pour le leadership verbal. Une première phase montre un équilibre des propos, suivie d'une phase d'opposition où chacun cherche à s'imposer jusqu'à sa domination verbale (et donc, la participation réduite de l'autre). Voici les volumes de parole lors des trois phases de la rencontre de H avec T, inconnu de H mais également alcoolique : |
|
|
|
| |
|
H |
|
|
|
|
T |
|
|
|
| Il apparaît que dans tous les
cas, l'alcoolique ne dispose que deux solutions
: obtenir l'ascendance ou se taire. (2) Lorsque deux alcooliques se connaissent, l'évolution est différente, comme si un accord permettait à chacun de satisfaire son "égotismes" :
|
|
Synthèse Dans tous les cas où l'alcoolique conserve la parole, nous observons :
Hors les conversations entre alcooliques, nous observons toujours la minoration de l'interlocuteur. L'alcoolique se satisfait d'un interlocuteur passif, sans histoire, sans parole, mais dont la présence lui est nécessaire. |
|
Synthèse Cette analyse révèle une contradiction, car si la familiarité habituelle suggère la proximité, l'interlocuteur astreint à se taire se voit plutôt mis à distance. En fait, l'alcoolique ne cherche pas à soumettre l'autre. Sa réaction ne paraît pas viser la personne mais ses paroles. Nous sommes en présence d'un système de défense profond et complexe. |
|
|
| II - TOUT SE COMPLIQUE : HYPOTHESES Qu'en est-il réellement de la conversation avec un alcoolique ? Que dire du malaise que ressent l'interlocuteur sobre pris dans cet écart entre la familiarité qui lui est imposée et le sentiment d'être nié ? Notre exploration montre deux faits dominants : - la tendance à se soustraire, non pas à autrui mais au discours d'autrui comme s'il fallait s'en protéger ; - l'abondance des répétitions, curieux phénomène dont il faut examiner les causes et les conséquences. Quels sont les pouvoirs de la répétition ? Les répétitions sont habituelles au début de l'existence dans le parler nounou (lolo, papa, dodo, momo...) quand l'enfant s'essaye au langage. Mais, en grandissant, il en abuse et sait en tirer parti. Ne harcèle-t-il pas les parents, ou ne se laisse-t-il pas harceler, jusqu'à s’entendre dire : "je ne te le répéterai plus !", "je ne te le dirai pas deux fois"? Voila qui l’incite à obéir alors qu’il s’accordait l’immunité et recueillait quelque tendresse tant qu'il obtenait des répétitions. On perçoit que la simple redite a un pouvoir : elle modifie la valeur de ce qui est dit. Ce phénomène, très général, apparaît bien dans les arts visuels que nous prendrons en exemple pour une meilleure compréhension. Si, en architecture, une image représente un homme, répétée comme motif décoratif, elle cesse de valoir pour ce qu'elle veut montrer et devient la partie d'un tout différent d'elle-même, la partie d'une frise, par exemple. Un changement de sens de la réalité est obtenu par le biais de la répétition de ce motif en tant que décor, et sa finalité est ainsi détournée. Sonore ou verbal, le phénomène est identique. Le refrain d’une chanson, les strophes d’une poésie, les rîmes et les rythmes, forment, en notre esprit, un ensemble par le biais de notre sensibilité esthétique. Chaque élément s’inclut dans le tout, en même temps que se resserre la distance temporelle qui les sépare. La répétition a le pouvoir de rapprocher ce qui est éloigné; elle rassemble dans un tout (contiguïté métonymique) ; ainsi contredit-elle, dans la pensée, la mise en comparaison ou en opposition (métaphore) qui suppose des ensembles distincts. Concurremment, le retour attendu dans le temps d'un mot, la réapparition d'une image, font de la répétition une figure de re-temporalisation. Le temps des événements n'est plus linéaire, continu, il devient cyclique, circulaire. C’est par la circularisation du temps vécu que nous pouvons comprendre tendance à se répéter des personnes alcooliques. Mais pour entrevoir ce qui les y contraint il convient de connaître le fonctionnement de la conversation usuelle. Comment la conversation fonctionne-t-elle ? La conversation a été définie comme "un échange verbal... continu dans le temps sans contraintes.... préétablies entre deux interlocuteurs se faisant face". La conversation est un échange de paroles dans lequel nous exposons et confrontons nos idées. Cela nécessite que l'on vérifie de façon continue l'existence, ou l’absence, de caractères communs entre les argumentations tour à tour proposées. Nous devons à chaque instant évaluer nos propres pensées et ce que dit l’autre, et voir ce qui est en accord ou désaccord, comparable ou opposable. Cette démarche dirige nos discussions et s'inscrit très exactement dans les postulats d'un procès métaphorique. C'est en effet la loi des conversations habituelles que de tendre à dégager un sens nouveau. Certes il existe d’autres façons de converser :
Finalement nous constatons que, selon le contexte, l'individu mobilise :
La question est maintenant de savoir pourquoi les alcooliques sont astreints à la répétition. Nous comprendrons du même coup pourquoi, malgré leur besoin de parler, ils supportent si mal une véritable conversation. D’où procède la récurrence temporelle chez l’alcoolique ? Il est à cela une raison précise qui, dans ce processus complexe, nous ramène à la pathologie de l'alcool : on sait que, sous le signe d'une autre répétition, celle du besoin, un réaménagement de la réalité s'opère en faveur de l'alcool. L'éthanol prend rang de substance nécessaire, que le corps réclame à très court terme. Dans l'affection évoluée, ce besoin oriente les conduites du patient vers la prévention du manque. (Au détriment des activités sociales et familiales). Cela n'est pas la conséquence d'un simple accaparement du temps. La personne alcoolisée ne vit pas dans le même ordre que les personnes sobres. Etant dans l'obligation de recréer sans cesse un état préexistant, elle ne suit plus le cours d'un temps linéaire, continu, qui est celui de tout le monde ou qui a été le sien avant la dépendance. (Sur ces questions voir aussi sur ce site : L'alcoolique et l'argent ou L'invention de la monnaie.) 1) circularité et linéarité temporelles Nous organisons nos journées en un temps pour travailler, un temps pour le loisir, pour la nourriture, l'hygiène du corps et de l'esprit. Certaines de ces activités se développent sur un mode linéaire, caractérisé par une continuité transformatrice ou créatrice de sens, donc engagées dans un projet défini comme métaphorique (production, activités salariées, gestion, développement). Pour d'autres (les rapports intimes à l'être, l’alimentation, la vie amoureuse, l’hygiène du corps, etc.) la répétition du besoin et la réappropriation de l'objet s'inscrivent dans une circularité, nullement créatrice de sens. Ces deux régimes temporels, où s'inscrivent des motifs d'action différents, sont mutuellement exclusifs. Ils sont rigoureusement séparés dans la vie courante parce que leur confusion est toujours subversive, sauf à être aménagée par un symbole ou un rituel. 2) la récurrence pathologique d'un assujettissement pulsionnel Peut-on percevoir que le besoin d’alcool de l’alcoolique n'est pas moins continu et impérieux que le besoin d'air de chacun ? Mais l'air est partout et l'apport en oxygène n'occupe pas nos pensées; à l'inverse, il faut se procurer l'alcool. Cela ne va pas sans problème pour le buveur, contraint de passer outre aux usages et laisser deviner ses besoins hors norme. Heureusement pour nos malades, les bistrots sont nombreux. Habituellement lieux de rencontre, ils deviennent lieux d'approvisionnement : il suffit d'y passer aussi souvent que possible et d'y rester aussi tard que possible. Retenons de ceci que le malade alcoolique se voit dans la nécessité permanente de recréer un état préexistant, obligé qu'il est à une répétition accélérée de l'acte de boire. Pour ces patients, toute confrontation à la réalité le soumet à une configuration pulsionnelle et gestuelle redéterminée sur un mode circulaire. Un conflit de configuration A ce point d’un parcours qui ne manque pas de complexité, l'hypothèse d'un rapport antagoniste entre le discours de l'alcoolique et celui d’une personne sobre se formule sous deux aspects : - pourquoi le patient ne peut-il intégrer la conversation ? - pourquoi use-t-il d’un recours constant à la répétition ? Car ce n’est pas le désintérêt pour l'autre qui détourne le patient de son interlocuteur. Le problème réside en ceci que le sujet normal et l'alcoolique, conversant ensemble, ne cheminent pas de la même façon dans leurs discours : l'un participe dans une visée de compréhension et d'analyse des idées en cours (figure d'intersection), l'autre ne peut exposer que son vécu personnel (figure d'inclusion). Plus simplement le sujet sobre, opte pour une conversation de salon qui nourrit toujours un versant intellectuel, en recherche d’analyse et de distanciation par rapport aux événements, tandis que l’alcoolique comme nous l’avons évoqué, ne peut se déployer que dans des confidences, des conversations de boudoir. C’est finalement l’antagonisme entre les deux ordres, métonymie / métaphore, qui fausse la rencontre entre les personnes. L'alcoolique, dans la nécessité d'esquiver le "processus conversationnel" dispose de deux moyens : se taire ou monopoliser la parole. Outre l'esquive il peut user de la répétition, comme le ferait l'enfant, pour transformer la valeur des propos, leur donner un autre sens, tout en usant des mêmes mots. (détournement des pouvoirs de la métaphore au profit de la métonymie). La compatibilité des thèmes Le procédé est cependant imparfait. Il laisse circuler certains thèmes, restant à comprendre pourquoi ceux-ci peuvent s'exprimer. * Le thème alcool. Ici, la possibilité paraît en rapport avec la répétition, mais une répétition inapparente. Maints auteurs ont noté ces étrange similitude dans les discours des alcooliques, dans leurs justifications et leurs alibis. Au point qu'ils apparaissent " [comme] un dictionnaire d'idées reçues, les porte-parole d'expressions toutes faites,...". Etant établi qu'il s'agit précisément d'idées reçues sur l'alcoolisme, le sujet qui les exprime, se trouve assuré de dire ce qui a déjà été dit. La répétition est donc acquise par anticipation et le locuteur s'exprime sans risque. * Mère et femme L’importance du discours sur la mère, en bonne place des thèmes recensés dans cette étude, indique là encore une compatibilité. Mais point besoin de répétition ici dès l'instant où la psychologie nous apprend l'impossibilité pour l’humain de métaphoriser la mère. Ce qui, pour notre objet, veut dire que la parole est impuissante à annuler les vestiges des relations remontant à l'enfance. Ce sont précisément ces vestiges qui assurent la perméabilité dont on parle, le discours sur la mère étant toujours intime. S'il suffit de désexualiser la femme pour retrouver la mère, c'est par ce procédé, a-t-on vu, que l'alcoolique parvient à l'introduire dans le discours. * Souffrance et persécution : la parole se fait plainte Un autre phénomène entre en jeu dans ce cas. La parole se faisant plainte ne se contente pas d'introduire une information dans la conversation. L'énoncé de souffrance "exerce une emprise sur la personne qui (le) reçoit". Ainsi, les propos qui suscitent une émotion sont-ils assurés de franchir la barrière que l'on sait. Mais nous sommes maintenant dans le domaine de l'écoute. Ces prédilections sont-elles un choix ? L'alcoolique a-t-il le choix de ces thèmes et de ces stratégies pour communiquer ? Tout laisse penser qu'il n'a le choix ni de l'un ni de l'autre. Ses possibilités de parole ne sont-elles pas restreintes à certains discours : ceux-là que relèvent l'étude linguistique ? Si certains thèmes apparaissent privilégiés, ils ne sont que des flux émergeant dans la masse informelle des discours. Toutefois une observation s'impose : les abus d'alcool durables sont toujours cachés. Une pudeur verbale affectera toujours la pulsion mise à nu au bistrot comme au cabinet médical. III CONCLUSION Derrière ces phénomènes les traits psychologiques de l’alcoolique, ont été décrits comme régressifs, marqués par la passivité, l'absence d'autonomie, le défaut d'initiative. Tous ces troubles disparaissent avec l'abstinence et sont sans rapports avec des problèmes de personnalité. Il demeure que ces perturbations affectent la relation, tant avec l'entourage qu'avec le médecin, aussi longtemps que dure l’intoxication. Nous y voyons qu'urgence à mieux connaître les problèmes linguistiques de l’alcoolisme tant sont fréquentes les relation manquée auxquelles exposent ces phénomènes complexes. |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |