
| Les
négations dans le discours pudique Les perturbations du langage sont essentielles à la compréhension de l'alcoolo dépendance. François Péréa Université Paul Valéry - Montpellier III E-mail :F. Péréa Vers le texte abrégé |
"Je l'ai fait", dit ma mémoire. "Je ne puis l'avoir fait" dit mon amour-propre, et il n'en démord pas. En fin de compte, c'est la mémoire qui cède. F. Nietzsche Nous nous attachons ici aux modalités et aux fonctionnements de certaines négations remplissant une fonction pudique, c'est-à-dire participant d'un ensemble de phénomènes langagiers présents lors d'un aveu, dans un discours honteux. Nous pouvons nous contenter, en préambule, d'une présentation large de la pudeur langagière: dans le discours, est marqué de pudeur ce qui ne peut être que difficilement dit à autrui, que ce dire puisse constituer une atteinte narcissique pour le locuteur ou (et) qu'il risque d'être une offense à la personne de l'interlocuteur. Dans ce contexte, la négation ne se contente pas de nier ce qu'il y a de honteux: elle permet aussi, nous le verrons, de dire ce qui était inavoué, sous couvert de stratégies de mise à l'écart et de défense. Nous nous concentrerons dans ces pages sur les négations avec le marqueur lexical ne/pas. Précisons toutefois que dans le discours oral, le premier terme (ne) peut disparaître à la suite d'un "écrasement phonétique" sans toutefois remettre en cause le fonctionnement de la négation à deux termes. Le matériau que nous utiliserons ici provient de plusieurs de nos corpus: * corpus de conversations entre alcooliques (ayant pour caractéristique le déni de leur état morbide); * corpus littéraire (ici : Bel-Ami de G. de Maupassant). * corpus d'entretiens privés et intimes. Après avoir présenté quelques approches de la négation, nous analyserons des occurrences de nos corpus. Ces analyses nous permettrons, dans un troisième temps, de présenter deux modalités de la négation dans le discours pudique (pour taire / pour faire) et un ensemble de remarques sur le lien entre la négation et la pudeur. 1. Préalables théoriques Les approches et typologies de la négation sont nombreuses. Cette pluralité s'explique par la complexité et la diversité des négations qui se laissent difficilement appréhender et expliquer d'une seule manière. Négation descriptive et négation polémique On distingue parmi les négations celles qui ont une valeur descriptive de celles qui ont une valeur polémique. La négation descriptive ne s'oppose pas, du point de vue de l'énonciation, à l'affirmation de l'interlocuteur ou d'un tiers (réel ou supposé). Sa valeur descriptive ne découle pas de la négation d'un autre énoncé mais de l'affirmation d'une propriété négative. Ainsi, en énonçant "Cette boisson n'est pas sucrée" à un diabétique, et si cet énoncé n'est pas une réaction à "cette boisson est sucrée", le locuteur ne fait que décrire (avertir). La négation polémique, au contraire, "sert à s'opposer à un point de vue susceptible d'être soutenu par un être discursif " (H. Nolke, 1993:234) et a deux variantes: - La négation métalinguistique dont Nolke dit qu'elle "peut porter sur les présuppositions [et/ou] sur le choix même des matériaux linguistiques" (1993:234). Ainsi, dans : "Je n'ai pas arrêté de fumer car je n'ai jamais fumé", la négation porte sur le présupposé (j'ai fumé). - alors que dans "ça ne m'a pas manqué mais ça m'a effleuré l'esprit" (cf. plus loin dans notre corpus; 6b) la négation porte sur le choix des termes. - La négation polémique à proprement parler repose sur un conflit d'opinion entre la forme affirmative antérieure et la forme négative. Elle maintient les présupposés. Négation polémique - négation descriptive, la distinction ne doit pas être manichéenne. Nolke précise en effet que "tout énoncé renfermant ne/pas véhicule une description, ne fût-ce qu'accessoirement" (1993:218) d'une part, et que la négation descriptive dérive de la négation polémique (l'auteur appelle ce phénomène "dérivation descriptive") par effacement du point de vue e1 (l'énoncé positif correspondant) d'autre part (1993:222). Négation complète - négation restreinte La négation est dite complète lorsqu'elle porte sur la proposition entière: elle consiste alors en une déclaration de fausseté de l'ensemble de l'affirmation correspondante. A l'inverse, la négation restreinte porte sur une partie de la proposition. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche exemplifient la distinction: "Les élèves n'ont pas cassé les vitres". S'il est faux que les élèves ont cassé les vitres, nous avons affaire avec une négation complète. Par contre, si les élèves n'ont pas cassé les vitres mais les craies, la négation est restreinte: elle ne porte plus sur la proposition entière mais seulement sur la partie "les vitres". Polyphonie, dialogisme et négation On peut également, à la suite des travaux de Ducrot (1984), concevoir la négation à la lumière de la polyphonie qui désigne la pluralité des voix sous-tendant un énoncé (déjà dit, emprunt, prises de distances, etc.) et permet de distinguer le sujet parlant (être physique, empirique, au-delà du langage) des instances discursives: le locuteur L (qui dit je), l'énonciateur E (qui assume la responsabilité d'un ou plusieurs actes de parole). Ainsi par exemple: "Je ne crois pas que leurs dirigeants [des différentes filiales de Vivendi-Universal], véritables artisans de cette formidable diversité, se lèvent chaque matin pour servir une pensée unique mondialiste qui serait l'aspiration suprême de Vivendi-Universal". Dans cet extrait d'une lettre de Jean-Marie Messier, président Vivendi-Universal, adressée à la rédaction de l'hebdomadaire Télérama suite à des propos qu'il juge en partie diffamatoires, il convient de distinguer le locuteur L (Jean-Marie Messier) de l'énonciateur E (la rédaction de Télérama). Même constat chez J. Bres, mais en référence aux travaux du cercle de Bakhtine sur le dialogisme cette fois-ci: "La négation pose la relation E1 [le Locuteur chez Ducrot]/ e1 [l'Enonciateur] comme agonale: E1 rejette comme fausse l'assertion de e1. Elle est l'outil parfait pour polémiquer avec l'autre" (1999:74). Ce que nous retiendrons de ces deux approches très voisines (la polyphonie de Ducrot et le dialogisme de Bakhtine) est la pluralité des voix qui se laissent entendre dans un énoncé. Dans le cas précis de la négation, l'altérité est dans l'affirmation à laquelle le locuteur s'oppose, cette altérité pouvant être plus ou moins inférée et renvoyer vers le co-énonciateur, un tiers, la doxa qui aurait affirmé ou chez qui le locuteur suppose l'affirmation possible. Négation, implicite, interprétation En guise de première approche de l'interprétation de la négation (une interprétation située dans le cadre de l'interlocution) nous présentons ici quelques pistes présentées par V. Allouche dans son article "Négation, signification et stratégies de parole". Avec Allouche, la négation est conçue comme un acte inter-énonciatif (1994:71) soumis à l'interprétation. Elle s'inscrit ainsi dans un processus de communication à quatre protagonistes: l'acte de langage est produit pour un récepteur donné; cet émetteur est aussi un énonciateur réel interprétant différent de l'énonciateur fictif construit par le récepteur. Dés lors, l'acte de communication se comprend dans: "un ensemble de paramètres socioculturels renvoyant aux savoirs supposés des sujets sur le monde (conventions sociales, statuts des individus, connaissances ou images impliquées par ces statuts, pouvoir reconnu) qui déterminent, pour une part, les rapports imaginaires entre les protagonistes du langage. Autrement dit, la compétence pragmatique de production des actes (assertifs, promissifs, directifs, expressifs, déclarations) fait partie intégrante d'une compétence plus vaste d'ordre psycho-socio-ethnoculturel" (1994:73). Dés lors, la signification ne peut être réduite à l'énoncé explicite mais dépend en grande partie des implicites liés aux circonstances du discours, lesquelles intègrent les savoirs supposés qui "circulent du monde que sont les pratiques sociales partagées" d'une part, et qui portent "sur les points de vue réciproques des protagonistes" d'autre part (p.73). En s'appuyant sur de tels présupposés théoriques, Allouche distingue trois stratégies de négation: a) les stratégies de refus qui sont conséquentes d'une attente du destinataire ou d'une demande de dire ou de faire; b) les stratégies de rejet ou de mise en question, qui sont conséquentes d'une interprétation du propos; c) les stratégies d'affrontement ou d'opposition, qui mettent en jeu, à travers un faire et les paramètres qui le structurent, des rapports de force entre les protagonistes. Nous retiendrons de l'approche de V. Allouche le jeu des tensions entre les protagonistes, tensions où se trament les rapports de force, de faces et l'importance des implicites dans l'acte d'interprétation. Discordance et forclusion J. Damourette et E. Pichon distinguent la fonction discordante du ne et la fonction forclusive du "strument d'abornement" pas (rappelons que nous restreignons notre approche au marqueur lexical ne/pas). La discordance, marquée par le ne, est une "relation établie d'emblée entre deux termes" (M. Arrivé ,1994 : 157). Le concept de discordance est assez large: il peut y avoir discordance entre la subordonnée et la proposition principale dans le cas de comparaison, ou encore entre le locuteur et l'énonciateur dans les cas de polyphonie. L'élément pas, lui, est forclusif. Le forclusif est chargé de rejeter un élément hors de la réalité envisageable. "L'atmosphère forclusive [à] ne procède en réalité pas de circonstances grammaticales matérielles, mais de motifs sémantiques d'ordre psychologique. On y est plongé toutes les fois qu'on gravite d'un fait présenté comme ne rentrant pas dans un envisagement facile de la réalité, la facilité devant s'entendre ici [à] sous le triple aspect de la probabilité, de la désirabilité et de l'attingibilité investigatoire" (Damourette et Pichon, 1911-1940:174). Pour reprendre un exemple des plus simples à Damourette et Pichon: "Je ne mange pas". ne marque la discordance par rapport à "je mange"; pas marque la forclusion. Au moment où je prononce la phrase, manger ne fait pas partie de la réalité que j'envisage, n'est pas "aperçu comme réel ou comme réalisable" (1911-1940:172). Le mérite revient à M. Arrivé d'avoir pointé le lien qui conduit de Pichon à Lacan. Il montre comment, dans le séminaire VII, Lacan assimile la discordance entre énonciation et énoncé au clivage (Spaltung chez Freud). La discordance participe ainsi de la distinction lacanienne entre sujet de l'énonciation et sujet de l'énoncé, deux sujets différents se méconnaissant tout en étant liés. De Pichon à Lacan, le lien se fait de la linguistique à la psychanalyse. Pour ce qui concerne la négation, nous pouvons poursuivre et terminer notre investigation avec la Verneinung de Freud. Négation, dénégation et déni Nous présentons la Verneinung freudienne en traduisant le terme allemand par "dénégation". Nous reviendrons immédiatement à la suite sur ce choix. Pour S. Freud, l'énoncé négatif peut être interprété de manière positive: "Nous prenons la liberté, lors de l'interprétation, de faire abstraction de la dénégation et d'en extraire le pur contenu des idées". Cette interprétation est rendue possible par le fait que ce qui est rendu dans le discours, nié par le moi, est un contenu qui peut être affirmé du point de vue de l'inconscient. Grâce à la dénégation, ce contenu peut passer le seuil de la conscience sous une forme négative. Le psychanalyste entendra donc la phrase (dé-)négative comme une déclaration que l'analysant n'est prêt à entendre comme telle: "Nier quelque chose en jugement signifie en fait: Voici quelque chose que je préférerai refouler [à] Au moyen du symbole de la négation, le penser se libère des limitations du refoulement et s'enrichit de contenus dont il ne peut se passer pour son accomplissement". La dénégation est donc moïque puisque dans l'inconscient les contenus contradictoires sont liés, ne s'excluent pas: Le non n'existe pas. Elle est ainsi une opération du moi par laquelle le sujet accueille intellectuellement un contenu de pensée tout en s'en défendant. La traduction de Verneinung a suscité de nombreuse polémique. Laplanche et Pontalis proposent (dé)négation. Roudinesco et Plon préfèrent dénégation et présentent de multiples traductions: négation (1934 - H. Hoesli; 1989 - J. Laplanche et A. Bourguignon); (dé)négation (1967 - J. Laplanche et J.-B. Pontalis), dénégation (1956 - J. Hyppolite ; 1997 - E. Roudinesco et M. Plon). Nous préférons distinguer la verneinung freudienne dans la traduction. En effet, toutes les négations ne sont pas des dénégations; toutes les négations (nous le verrons) ne viennent pas barrer l'affirmation d'un contenu inconscient insoutenable. Au contraire certaines occurrences nous montrent que la négation peut permettre d'affirmer: le locuteur nie le contenu opposé de ce qu'il veut dire. De même, certaines négations, si elles ont vocation à cacher une "vérité", ne la cachent qu'à autrui: le locuteur a conscience de son mensonge mais ne veut pas ou ne peut pas, dans les circonstances et dans la relation, affirmer le contenu nié à son allocutaire. Nous considérons donc la dénégation comme un type de négation, ce type se distinguant des autres d'un point de vue psychologique. Précisons que nous emploierons dénégation dans le sens et les circonstances qui sont ceux de Freud, mais que nous l'utiliserons aussi d'une manière plus large. En effet, il nous est impossible de savoir si ce qui est nié peut être affirmé d'un point de vue inconscient. Nous emploierons donc dénégation dans les cas où ce qui est nié paraît être indubitablement vrai et ou cette vérité semble échapper à l'énonciateur. Pour terminer cette première approche de la verneinung (sur laquelle nous reviendrons), il convient de la distinguer de la verleugnung habituellement traduite par déni et s'écrivant désaveu sous la plume de G. Risoloto. Le déni renvoie à une double opération de reconnaissance puis de refus. Le sujet accepte dans un premier temps, sous sa forme positive, affirmative, le contenu jusqu'alors refoulé, puis le remet en cause. Autrement dit avec des exemples: - dénégation : "j'ai rêvé d'une femme, ce n'était pas ma mère" (le psychanalyste entendra : "c'était ma mère" ; l'exemple est de Freud); - déni : "j'ai rêvé d'une femme, je sais bien que c'était ma mère. Mais quand même" (l'exemple est de M. Mannoni). 2. Présentation d'occurrences Nous présentons dans ce chapitre des occurrences du corpus. L'objectif est de les décrire brièvement en utilisant les outils que nous venons de présenter lorsque ceux-ci nous semblent pertinents pour l'exemple. Par la suite, nous verrons comment ces descriptions sont utiles et doivent être prolongées et discutées pour comprendre le phénomène de la négation dans le discours pudique. (1) "Le whisky, je l'aime pas" {il ne s'agit pas de la boisson que l'alcoolique consomme ce jour-là mais de l'une de ses boissons privilégiées !} Si l'on accepte la définition large et momentanée que nous donnions plus haut de la dénégation (nier ce qui est "réel" et nous ne savons pas si ce vrai est su par le locuteur), nous pouvons considérer cette occurrence comme telle. En effet, le locuteur dit ne pas aimer une boisson qui est une de celle qu'il privilégie même si ce jour-là, il consommait autre chose. Intégrée dans une séquence d'échanges, la description est polémique: elle apparaît en réaction à "Le gars il nous servait des whiskies". (2) "on est tous plus ou moins alcoolique [...] ah, j'ai pas dit rond (2a), alcoolique c'est différent, c'est pas la même chose. Moi, des fois, j'ai bu des canons mais je suis pas... tu ne me verras pas tituber ni rien du tout (2b)". La négation (2a) est de type polémique métalinguistique: elle concerne le signifiant rond que le locuteur écarte au profit d'alcoolique. Elle apparaît comme un acte inter-énonciatif et dialogique. On la comprend, avec Allouche, comme une "stratégie de rejet ou de mise en question [conséquente] d'une interprétation du propos" (1994:73): le locuteur précise ce qui pourrait être mal compris. Dès lors, une autre voix se fait entendre: celle qui s'en tiendrait au signifiant rond, et qui serait celle que le co-énonciateur aurait (mal) entendue. Notons enfin que pour cette première négation, l'approche de Damourette et Pichon est instructive: on remarque que la forclusion concerne le rond c'est-à-dire l'adjectif stigmatisant, désignant le honteux: celui est rejeté hors du champ du "on" dans lequel le locuteur est inclus. La négation (2b) s'inscrit dans la continuité de la première: du point de vue dialogique, sa forme positive correspond à celle qui affirme que "on" est rond; l'élément forclos est lui aussi dépréciatif (l'acte de tituber de l'ivrogne). Il est intéressant de noter la succession des négations dans ce passage où il est question, pour le locuteur alcoolique, de se définir dans son rapport à la boisson. Nous n'avons pas affaire avec une définition positive mais négative: le sujet rejette tout ce qu'il refuse, "conformément" au déni de ce type d'alcooliques qui refusent de reconnaître la morbidité de leur comportement. Dès lors, on se demande (comme nous y incite l'alcoologue) si ce qu'il rejette n'est pas "justement" ce qu'il y a affirmé. (3) ... Mme de Marelle: "[...] J'ai le désir de faire un tour, je ne vois pas en quoi cela peut te fâcher". Il se leva exaspéré (Georges Duroy / Bel Ami): "ça ne me fâche pas. Cela m'embête. Voilà!" La négation de Bel-Ami est "polémique", de type métalinguistique: elle porte sur un signifiant (fâcher) que le locuteur refuse pour qualifier son état. La polyphonie de la négation est ici claire: Duroy reprend le terme de sa maîtresse, Mme de Marelle, pour le nier et en préférer un autre (embêter). Ce cas est donc celui d'une stratégie de rejet du propos d'autrui qui sous-tend une interprétation mise en question (V. Allouche, cas b). (4) Le locuteur est un homme marié qui s'est toujours défini comme un hétérosexuel: "T'aime l'inattendu?" "Le choquant?" "Heu {pause} rapport à la première expérience sexuelle {pause} c'est pas avec une femme {pause} voilà mon scoop!" La négation est restreinte: Elle porte sur le signifiant femme. Il est important de préciser qu'elle s'inscrit comme négation (auto) polémique métalinguistique: Le locuteur s'oppose dialogiquement à un dire précédent consistant en un récit de sa première expérience sexuelle avec une femme. Ici, la forclusion de femme montre combien celle-ci n'appartient pas à la réalité du vécu de la première expérience. L'homme non-dit dont il est question est pourtant bien présent: Selon le carré d'Aristote (voir º 3.2) mettant en évidence les relation de contrariété et de contradiction, "ne pas être avec une femme" implique, dans ce contexte, "avec un homme". (5) "Mais je suis pas contre (5a) {longue pause} si c'est avec un homme, ça m'a pas manqué mais ça m'a effleuré l'esprit (5b) mais pas vivre avec quelqu'un ou tu vois venir ... Non si ça m'était arrivé euh {pause} par hasard machin un soir heu {pause} je sais pas c'est ce serait pas non quoi (5c) mais ça c'est pas fait et puis voilà". La négation (5a) est plutôt descriptive et elle est restreinte, portant sur le contre. Ici aussi, elle consiste en l'évitement de l'affirmation: le carré d'Aristote implique un "je suis pour" qui suppose une prise en charge subjective plus importante. Nous trouvons en (5b) une négation et une assertion coordonnées. La négation, prise séparément, est plutôt descriptive mais la conjonction crée la polémique: "ce n'est pas a mais b". La discordance concerne l'absence totale de manque et l'assertion peut-être comprise comme une concession en ce sens qu'elle ne joue pas l'opposition totale mais la modalisation (être obsédé par une pensée / n'y penser qu'un peu). Dés lors, on peut décrire ces deux syntagmes comme relevant du déni: "j'y pense un peu mais quand même... pas beaucoup". Deux négations se succèdent en (5c). "Je sais pas" est descriptive: elle renvoie au doute, à un savoir quasi-forclos, comme s'il était craint. Ce savoir est finalement dit par implication: "ce serait pas non" suppose que "ce serait oui" (le conditionnel reste comme marque du doute). La première négation peut être entendue comme une dénégation. Soulignons dans ce passage la multitude des négations qui apparaissent lorsque l'aveu coûte à celui qui le produit. (6) {B. avoue quelques minutes avant qu'il désire J.} "comme J., la dernière fois elle a dit en rigolant que je téléphonais toujours, que je voulais coucher avec elle. J'étais mal. N'importe quoi! Je veux pas coucher avec toi!" Nous trouvons ici un cas de stratégie d'affrontement (ou d'opposition) telle que la définit V. Allouche comme "rapport de force entre les protagonistes" (1992:74). En effet, B s'oppose à la jeune fille (e1 est l'énoncé de J: "elle a dit [...] que je voulais coucher avec elle"). La négation est donc polémique et on peut la qualifier de complète. Nous ne pouvons parler ici de dénégation ou de déni puisque le locuteur a parfaitement conscience de son penchant pour J: cette négation est un mensonge. (7) L'enfant vient de renverser son verre et accuse son frère: "C'est pas moi, c'est I." Ici encore, nous trouvons un exemple de négation polémique (en réaction à l'accusation parentale) qui correspond à une stratégie d'affrontement. La négation est restreinte: elle porte sur le pronom personnel moi auquel sera substitué le prénom du frère. A nouveau, nous ne pouvons parler ici de dénégation ou de déni puisqu'il s'agit d'un mensonge qui ne trompe qu'autrui. 3. Les négations pudiques La pudeur se présente comme une ligne de partage, fluctuante, mobile selon la situation, celui à qui on s'adresse, selon son humeur, sa force ou sa fragilité du moment. Une ligne de partage donc, qui délimite, dans l'instant, "l'entre-deux" qui détermine la parole: "Dans l'entre-deux, entre le savoir par lequel il s'identifie à un objet et la vérité qui pose la question de son rapport aux autres dans une référence à l'origine et à la fin, la pudeur avec laquelle l'homme se révèle en son corps dit la division d'où naît le sujet parlant" (D. Vasse; 2002:198). La pudeur est tension, double tension à autrui et soi-même. A autrui, parce que la parole prononcée à son adresse, portée à son attention, ne doit pas le choquer, le gêner, plus que ne le permet la règle sociale; à soi-même parce qu'entre "savoir et vérité", représentation et réel, conscient et inconscient, la pudeur pose le voile sur l'inconcevable, l'indicible. Aussi hétérogène soit-elle et nombreuses soient ses formes, la pudeur se situe toujours entre un non-dit et un dit (car la retenue fait bien barrage à une force, à un courant de parole). Cependant, nous aurions tort de considérer la pudeur uniquement comme un empêchement du dire. En effet, elle peut aussi être la précaution sans laquelle la parole ne peut advenir. Pour revenir au cas de la négation, on remarque que l'aveu est très souvent accompagné de celle-ci (cf. exemple 5 supra). Qu'en est-il de la pudeur dans les extraits que nous avons présentés? En guise d'approche générale du fonctionnement pudique des négations, on peut proposer une distinction entre celles qui disent et celles qui taisent. 3.1. La négation pudique pour le taire Le dictionnaire Larousse définit la vérité comme: 1. Caractère de ce qui est vrai ; adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. 2. Idée, proposition qui emporte l'assentiment général [...]. La vérité apparaît ainsi comme une construction phénoménologique, une objectivité somme / moyenne des subjectivités (acception 2) ou comme adéquation consensuelle entre perception et conception (acception 1). Le psychanalyste emploiera réel pour désigner ce qui n'est pas symbolisable. Le réel échappe donc au sujet qui se meut dans les rets d'une réalité, du langage. La distinction vérité / réel est une des apories du linguiste: face au non-dit, celui-ci ne sait souvent pas si le locuteur ne veut pas dire une vérité dont il a conscience, ou s'il ne peut pas dire un réel barré, impensable dans le cas du déni ou de la dénégation. En ce qui concerne la négation, le linguiste ne peut pas toujours faire le choix entre le mensonge (le locuteur nie ce qu'il sait vrai) et la dénégation ou le déni (le locuteur refuse le réel, s'inscrit en discordance (pour reprendre le mot de Damourette et Pichon par rapport à celui-ci). Dans les extraits que nous avons présentés, seules les occurrences (6) et (7) peuvent être qualifiées de mensongères avec certitude: (6) Je ne veux pas coucher avec toi (alors que le locuteur a fait part de ce désir); (7) C'est pas moi, c'est I. (alors que l'enfant vient de commettre la bêtise et ne veut pas se faire punir). Les autres occurrences nous confrontent à l'aporie. L'extrait (5b), sur l'aveu de penchants homosexuels, semble aussi être du ressort du déni: ça m'a pas manqué mais ça m'a effleuré l'esprit, par le recours à la double opération de refus, concession moins "compromettante". Enfin, dans l'extrait de Bel Ami, nous savons grâce à l'auteur que les sentiments de Duroy sont très intenses ("il se leva exaspéré") alors que le locuteur les minimise en réaction à Mme de Marelle: Cela ne me fâche pas, cela m'embête, c'est tout. Bel-Ami ment-il délibérément à sa maîtresse ou se trompe-t-il lui-même? Qu'elle soit partielle (refus d'un signifiant, d'une dénomination) ou complète (proposition entière), la négation peut remplir une fonction pudique de retenue, de discrétion, dans les cas que nous venons de voir. Cette fonction peut-être liée à la crainte de la réaction de l'autre (sanction de l'enfant en 7), réaction d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans une relation spéculaire. E. Goffman pointe comment nous sommes soumis à une censure non consciente de nos actes qui pourraient contrevenir aux rituels sociaux en place et l'importance du face-work dans nos interactions quotidiennes. Au-delà de la guidance culturelle de nos comportements, il faut souligner la répercussion du regard d'autrui sur l'image de soi, image liée au discours prononcé (en ethos) qui va guider ce dernier en amont (..."l'homme parlant parle l'écoute qu'il imagine à sa propre parole" écrit R. Barthes) et en aval (la réaction de l'autre peut-être dénarcissisante). L'approche proposée par V. Allouche (1994) est, dans ce registre, particulièrement intéressante puisqu'elle pose la question du rapport à autrui et des interprétations des propos. La prise en compte de certains phénomènes dialogiques permet elle aussi de pointer le travail de positionnement en rapport aux discours des autres, de la doxa. Mais elle peut tout aussi bien (et les deux ne s'excluent bien évidemment pas) être liée à une dynamique des instances de la psyché qui occulte ce qui pourrait contrevenir à l'équilibre moïque. Dans le cas précis de la négation, on ne peut parler de refoulement car il y a quelque chose de dicible, mais de retour du refoulé sous une forme négative (dénégation) ou désinvestie et partiellement refusée (déni). Les phénomènes de discordance et de forclusion mériteraient d'être ancrés dans cette perspective. Dans les deux cas (dénier / mentir), la négation pudique vient pointer un refus du positionnement, de l'image (pour autrui ou soi): refus d'être l'ivrogne stigmatisable (en 2a) ou l'homosexuel au désir irrépressible (5b), par exemple. La négation pudique pointe alors l'indicible (à soi-même) ou le caché (à autrui); l'occultation, le masquage. 3.2. La négation pudique pour le dire Si la négation est un moyen de ne pas dire, ou de s'inscrire en discordance avec le dit, elle permet également d'affirmer, non sans quelques précautions. Dans nos extraits nous trouvons les négations restreintes suivantes: (4) la première expérience sexuelle {pause} c'est pas avec une femme; (5a) mais j'suis pas contre {pause} si c'est avec un homme; (5c) Si ça m'était arrivé heu {pause} par hasard machin un soir heu {pause} je sais pas c'est ce serait pas non quoi. Il est intéressant de souligner que toutes ces négations sont restreintes; elles portent sur un signifiant : femme, contre, non. Partant de là, on peut démontrer comment le sens apparaît à la suite d'opérations de contrariété, contradiction et implication. Pour ce faire, nous utilisons le modèle appelé "carré d'oppositions" ou "carré d'Aristote". être heureux---------CONTRAIRES---------être malheureux 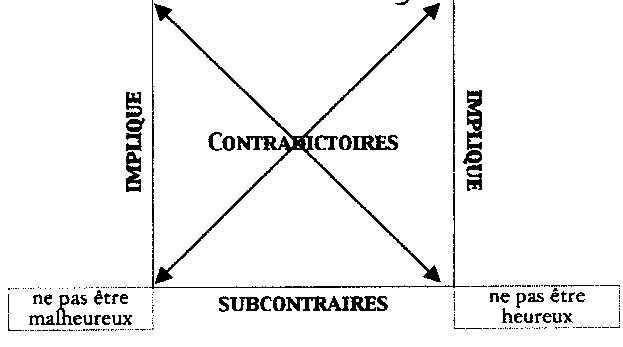 Ce carré est valable pour des paires antinomiques (bien et mal, vrai et faux, chanceux et malchanceux). Il suppose une et une seule alternative (dans un contexte discursif précis). Ainsi, il n'est pas valable pour l'extrait (3) "cela ne me fâche pas, cela m'embête", puisque l'alternative n'est pas ici "cela me ravit". Il est par contre parfaitement pertinent pour les extraits (4), (5a) et (5c). Les paires opposées (dont un seul terme est donné) sont ici (et dans les contextes précis): homme/femme (4), pour/contre (5a) et oui/non (5c). Le sens de l'énoncé résulte alors d'une opération de contrariété (axe des contraires) suivie d'une opération de contradiction (axe des contradictoires) qui conduit à l'implication: (5a) Je ne suis pas contre. 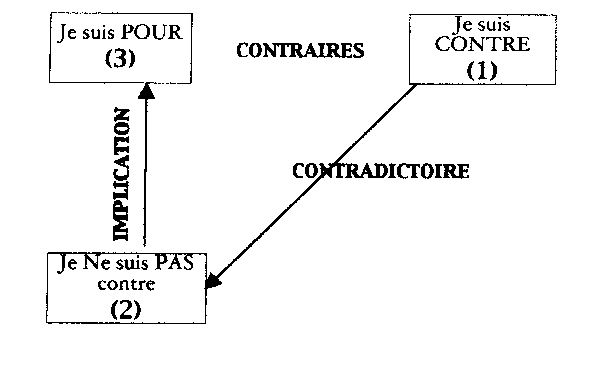 1. Sélection de l'antonyme ("contre" à la place de "pour"); 2. Négation syntaxique (ne/pas) de l'antonyme; 3. On obtient une affirmation par implication. Grâce à ce procédé, la négation du contraire permet l'affirmation sans avoir à prononcer le signifiant positif et sans utiliser la forme asseritive qui suppose, dans ces cas, une implication subjective plus importante. Dès lors, la négation apparaît sous sa forme pudique en ce qu'elle permet l'affirmation sans avoir à en supporter la prise en charge totale. Ainsi, elle permet grâce à ce double détournement d'affirmer: (4) "ma première expérience sexuelle > c'est avec un homme"; (5a) "je suis pour < si c'est avec un homme"; (5c) "ce serait oui < avec un homme". La négation pudique, permettant de dire avec précaution sans avoir à énoncer la forme affirmative "honteuse", est accompagnée d'autres procédés de minimisation. On relève ainsi de fréquentes hésitations (nombreuses pauses dans les passages d'aveu, "euh"), des restrictions conditionnelles (conjonction de subordination "si", conditionnel, "mais pas vivre avec un homme"), la mise en avant de l'absence de passage à l'acte ("mais ça c'est pas fait"), l'annonce du caractère exceptionnel ("inattendu", "voilà mon scoop"), etc.. La négation pudique et les précautions qui l'accompagnent soulignent ainsi que la parole est difficile, partiellement assumée, exceptionnelle et extraordinaire; une parole d'aveu où se dit ce qui jusqu'alors ne pouvait qu'être tu, le honteux, le secret. 3.3. Les négations et la pudeur La pudeur langagière s'inscrit en tension entre l'indicible et le dit. Elle occupe cet espace frontalier et accompagne l'aveu, la venue de la parole. La négation rend compte de ce passage par paliers, du taire au dit. i. Au départ, il y a l'indicible absolu, barré, refoulé, qui ne parvient au sujet sous aucune forme. ii. Le nier à soi-même se présente sous la forme de la dénégation (la représentation n'est plus refoulée: elle parvient à la conscience, mais sous une forme niée) ou celle du déni (la représentation est dénigrée, n'est pas acceptée pour ce qu'elle est). iii. Le nier à autrui renvoie au mensonge: le sujet a conscience du contenu qu'il juge honteux et/ou préfère le cacher à autrui par crainte de sa réaction. La négation à soi-même ou autrui peut être simple (extraits 1, 2b, 6) ou accompagnée d'un recadrage (2a, 3, 5b, 7). iv. La négation pour dire est une des précautions de la parole d'aveu: elle permet de ne pas affirmer pleinement le dire honteux, le signifiant tabou, que ce dire choque l'énonciateur, le co-énonciateur ou les deux à la fois. v. Le dit enfin (s'il n'est même pas soumis au déni) consiste en l'affirmation assumée de l'objet de discours et du discours lui-même pris en charge, accepté. Cette progression théorique est réductrice: Elle n'a pas vocation à rendre compte de tous les possibles ni même du devenir de toute représentation indicible. Elle nous permet juste de souligner la place des différentes négations pudiques (taire à soi, à autrui / dire avec précaution). Elle pointe comment la pudeur compose avec le honteux et s'inscrit en tension entre soi et autrui, dans la trame de la rencontre où s'inscrit et prend forme la subjectivité, la représentation de soi. Les différentes approches de la négation, que nous avons pointées précédemment nous invitent à cette rencontre avec la pudeur. L'approche dialogique de la négation pointe, d'une manière générale, l'inscription et la traversée d'un énoncé par les discours précédemment tenus, soutenables, en une chaîne socialisée, soumise à des régulations normatives, des jeux de références déterminant un certain champ du dicible. Elle souligne également l'importance de l'autre que considère également la distinction entre négation polémique et négation descriptive, la première soulignant le conflit d'opinion. Nier, dans cette perspective, revient à manifester son désaccord et l'on devine déjà qu'il y a parfois intérêt à se taire. V. Allouche approfondit la question et pointe le positionnement du locuteur par rapport à autrui, ses attentes, son interprétation supposée du propos, ses propres positions. De plus, il pose un "terrain" "psycho-socio-ethnoculturel" à la rencontre qui nous convie à dépasser le seul matériau linguistique. La tension apparaît jusqu'à un certain point où le locuteur préfèrera mentir pour éviter de décevoir les attentes d'autrui, s'opposer à lui, risquer son interprétation et son jugement, et ainsi modifier l'image de lui-même qui lui sera renvoyée: pitié, moquerie, critique, courroux. Enfin, il peut arriver que dans son histoire le locuteur pousse ce mensonge jusqu'à se tromper lui-même. Après avoir marqué la discordance, il forclot le propos et/ou son objet et s'en détourne jusqu'à la négation, le déni, comme il lui fait honte. 4. Conclusion Notre objectif n'est évidemment pas de décrire toutes les négations. De nombreux outils et théories existent qui remplissent cette tâche. Nous en avons croisé certains. Nous souhaitons seulement présenter divers fonctionnements de la négation dans le discours pudique, d'aveu. On remarque en effet que la négation a, dans ce contexte, une importance quantitative particulière et qu'elle remplit plusieurs fonctions en posant le voile de la pudeur (négations pour le "taire", renier) ou soulevant celui-ci avec précaution (négations pour le dire). De ce point de vue, les modalités et fonctionnements de la négation pudique pointent le travail subjectif et intersubjectif sous-tendant la parole, travail "à vif", dans la parole d'aveu, le discours sur ce que les participants peuvent juger choquant ou honteux. Ils soulignent ainsi le travail de défense et d'élaboration éthique de la parole, et le leurre du jugement qui conduirait à penser que "le langage devrait être fidèle comme la perception devrait être véridique" (V. Jankélévitch). Et E. Sapir d'ajouter: "Quand un homme parle, nous dit-on, c'est qu'il veut faire part de quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire. Il se propose de dire quelque chose ; mais ce qu'il dit peut-être très différent de ce qu'il avait l'intention d'exprimer. Ce qu'il ne nous dit pas nous renseigne sur ce qu'il est, et nous serions bien avisés de ne pas fonder notre jugement uniquement sur le contenu explicite de ses paroles. Il faut lire entre les lignes, même si elles ne sont pas écrites en noir sur blanc" (E. Sapir; 1967:55). Bibliographie - Allouche V., 1994, "Négation, signification et stratégies de parole", Langue Française 94. - Amossy R. (sous la direction de), 1999, Images de soi dans le discours - La construction de l'ethos, éd. Delachaux et Niestlé. - Arrivé M., 1994, Langage et psychanalyse ; linguistique et inconscient, éd. PUF, coll. "Linguistique nouvelle". - Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., 1989, La grammaire d'aujourd'hui ; guide alphabétique de linguistique française, Flammarion.. - Barthes R., en préface de l'ouvrage de R. Flahault, La parole intermédiaire, éd. Du Seuil. - Bres J., 1999, "Vous les entendez? Analyse du discours et dialogisme", Modelés linguistiques, tome XX, fasc. 2. - Damourette J. et Pichon E., 1911-1940, Des mots à la pensée - Essai de grammaire de la langue française, éd. D'Artey. - Freud S., 1982 (trad.), Die Verneinung, trad. Fse de J.-C. Capéle et D. Mercadier dans le discours psychanalytique. - Goffman E., 1963, Stigmates, éd. de Minuit. - Jankélévitch V., 1964, L'Ironie, Flammarion, coll. "Nouvelle bibliothèque scientifique". - Mannoni "., 1969, Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre Scène, éd. Du Seuil. - Nolke H., 1990, "Formes et emplois des énoncés négatifs : polyphonie et syntaxe de ne/pas", Revue Romane, n°25. - Nolke H., 1993, Le regard du locuteur, "Ne/pas : négation descriptive ou polémique? Contraintes formelles sur son interprétation", éd. Kimé, Paris. - Nolke H., 1994, "Ne pas : négation descriptive ou polémique? Contraintes formelles sur son interprétation", Langue française 94. - Sapir E., 1967, Anthropologie, éd. De Minuit, coll. "Points". - Vasse D., 2002, "Un monde sans pudeur?", dans Etudes, n°3962, février 2002. - Winther A., 1990, "La négation complexe est-elle menacée en français contemporain?", Europe, n°738, octobre. Notes F. Nietszche, Par-delà bien et mal. Masquage de la personne, glissement sémantique, etc. Cf. J. Damourette et E. Pichon, Des mots à la pensée - Essai de grammaire de la langue française, 1911-1940. Tome 6 page 130, édition d'Artey. Cf. A. Winther, 1990, "La négation complexe est-elle menacée en français contemporain?", Europe, n° 738, octobre. H. Nolke, 1993, ibid., "Formes et emplois des énoncés négatifs : polyphonie et syntaxe de ne/pas". Nous précisons les chapitres car ils reprennent des articles éponymes de l'auteur (voir bibliographie). M. Arrivé, F. Gadet, et M. Galmiche, 1989, La grammaire d'aujourd'hui ; guide alphabétique de linguistique française, Flammarion, p. 397. Le locuteur peut être divisé en L (fiction discursive, sujet de l'énonciation) et, l, celui dont on parle, sujet de l'énoncé. (cf. la présentation de R. Amossy, 1999 : 15 ; voir bibliographie en fin de texte). Cette lettre est paru dans Télérama n°2717 (du 9 au 15 février 2002) en réaction aux articles parus dans le numéro précédent. J. Bres, 1999, "Vous les entendez? Analyse du discours et dialogisme", dans Modèles linguistiques, Tome XX, fascicule 2. V. Allouche, 1994, "Négation, signification et stratégies de parole", dans Langue française, n°94 intitulé "Les négations", Larousse. Nous ne développerons pas ici les rapports entre l'implicite et la pudeur, nous contentant d'une approche large du phénomène. J. Damourette et E. Pichon, 1911-1940, Des mots à la pensée ; essai de grammaire de langue française, Tome 6me, éd. D'Artey. M. Arrivé, 1994, Langage et psychanalyse ; linguistique et inconscient, Puf, coll. ½ Linguistique nouvelle". Il se distingue, dans la terminologie de Damourette et Pichon, des autres "struments d'abornements" que sont les uniceptifs, (comme "que" dans : je ne mange que des oranges). Nous nous référons ici à une traduction de cet article (de 4 pages) effectuée par J.C. Capéle et D. Mercadier, parue en 1982 dans Le discours psychanalytique et reproduit en version bilingue à cette adresse électronique : www.khristophoros.net/sf1.html. 1967, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF. 1997, Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard. Nous sommes conscient des acceptions abstraites et fluctuantes des mots vérité, vrai, etc. Travaillant sur les occurrences, nous aurons l'occasion de préciser notre propos. Mannoni, 1969, Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre Scène, éd. Du Seuil. Dans le discours de ce locuteur, l'alcoolique est tout au plus un gros buveur et n'est en rien stigmatisable. G. de Maupassant, 1973, Bel-Ami, Gallimard / Folio, p. 133. D. Vasse, 2002, "Un monde sans pudeur?", dans Etudes, n°3962, février 2002. E. Goffman, 1963, Stigmates, éd. De Minuit. R. Barthes, en préface de l'ouvrage de F. Flahault, 1978, La parole intermédiaire, éd. Du Seuil. V. Jankélévitch, 1964 (éd. citée), L'Ironie, Flammarion, coll. "Nouvelle bibliothèque scientifique". E. Sapir, 1967, Anthropologie, éd. De Minuit, coll. "Points". [Note de JPM : Aucun renvoi des notes au texte dans le fichier original du Dr Morenon. Et là j'avoue, j'ai renoncé. Mais si quelqu'un se propose...] |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |