
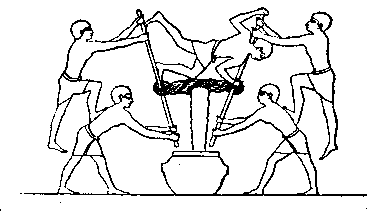 | NOTE SUR L'USAGE ANTIQUE DES BOISSONS ALCOOLISEES |
Sources : A. Herman et H.Ranke, La civilisation égyptienne. Payot, Paris 1952. Voir aussi : sur ce site "A votre santé !". On trouvera sur le site de la revue Pour la Science un article très documenté : L'histoire des boissons alcoolisées par le Professeur Bert Vallee, membre de l'Académie des sciences américaine, Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Harvard. [Note de JP. Morenon : Sur le site de la revue "Pour la Science", les archives ne font pas état de la publication de cet article que je n'ai pas réussi à retrouver. Un site québécois le référence pourtant dans le n°250 d'août 1998. La version anglaise de l'article, publié dans la revue Scientific American est consultable ici. Voir également l'article mis en ligne dans le site "search.com"] Dans le problème de l'alcoolisme l'enracinement culturel est reconnu par tous pour être souvent déploré, il est rarement étudié dans toutes ses dimensions. Sa connaissance n'en est pas moins essentielle car dans toute action, thérapeutique ou préventive, le langage efficace est celui qui reflète une certaine vérité. Que celle-ci soit variable historiquement, ne rend que plus nécessaire l'étude de cet enracinement. D'un point de vue anthropologique il n'est pas illégitime de penser que l'importance culturelle, religieuse, économique acquise par les boissons fermentées n'ait été directement liée à un certain bénéfice objectif que l'humanité, dans son développement, a su tirer de leur usage. C'est d'ailleurs lorsque ces dimensions sont respectables et respectées, surtout dans les régions de viticulture familiale, que l'alcoolisme semble-t-il, sévit le moins. De nos jours, la dénégation naïve, explicite ou non, de ce versant positif ne laisse au discours thérapeutique, ou à la prévention, que l'efficacité précaire d'un déni, aggravé par une approche réductrice en terme de plaisir. Ceci ne manque pas d'influencer le regard trop sommaire que l'on jette sur l'usage antique de ces boissons et qui ne renvoie généralement qu'à une image dionysiaque, volontiers cultivée par certains publicitaires modernes. L'efficacité douteuse d'un déni Une réalité bien différente apparaît à l'examen des documents abondants et précis qui nous sont parvenus. Ils nous apprennent que les anciens ont certes eu maille à partir avec les méfaits de l'alcool, qu'ils ont édicté des lois répressives, mais qu'ils ont eu, pour développer la connaissance, la fabrication et l'usage des boissons fermentées, d'autres motifs que la recherche de plaisir, et peut-être d'abord, la préservation de leur santé. L'Egypte antique offre ceci de particulier que les documents qu'elle nous a transmis sur la fabrication de ces boissons ne sont pas nécessairement des textes sacrés mais des documents comptables, administratifs ou techniques. Elle est en cela un modèle dont l'étude est riche d'enseignement. Il saute aux yeux que la production et la consommation de vin et de bière connaissaient dans ce pays un développement économique évident, mais dans un contexte ou précisément l'hygiène des eaux de boisson constituait un problème majeur. Si le pain et la bière étaient les aliments dont le défunt souhaitait disposer pour son voyage dans l'au-delà c'est bien à la mesure de leur importance dans l'existence terrestre. C'est donc par les rîtes funéraires que des informations nous sont parvenues. Avec une grande précision les représentations tombales nous décrivent la préparation de la bière. Le grain est broyé dans des mortiers de pierre avec de grands pilons. On l'humecte ensuite pour en former des pains qui subissent un légère cuisson. Ces morceaux sont écrasés sous les pieds d'un homme, ou d'une femme, dans une cuve à fermentation. La masse fermentée est ensuite déposée sur un tamis d'osier et pétrie à la main. La bière est exprimée et récoltée dans de grands récipients de terre cuite. Elle est ensuite décantée dans des jarres enduites de poix que l'on ferme au moyen de bouchons de limon. C'est par un procédé peu différent que les Fellah de Haute-Egypte et de Nubie fabriquaient il y a peu une sorte de bière : la pousa qui a, malheureusement, l'inconvénient de ne pas se conserver. Connaisseurs, les Egyptiens appréciaient aussi la bière d'importation, celle de Kech, dans le sud-est de l'Asie Mineure, mais qui, sous ce nom, était peut-être aussi brassée en Egypte. Sous l'Ancien Empire on connaissait quatre variétés de cette boisson, consommée aussi loin que l'on puisse remonter dans le passé. Des techniques élaborées... La vigne était cultivée près du delta mais sur des levées de terre artificielles hors des terrains marécageux qui ne lui sont pas propices. 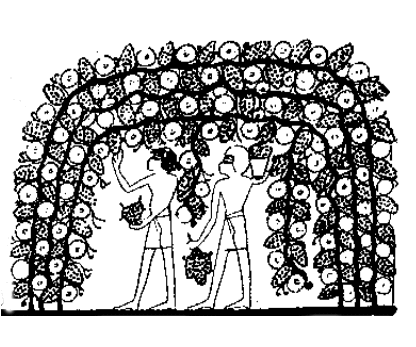 Là encore les peintures tombales nous renseignent. Dans les vignobles, les vignes sont soutenues par des pergolas, arrosées, et protégées des oiseaux. Les vendanges se font dans des corbeilles. Au rythme d'une chanson la récolte est foulée aux pieds dans une cuve en pierre, surmontée d'un châssis de bois que saisissent les fouleurs pour maintenir leur équilibre. Rien n'est perdu: Le résidu est placé dans des sacs que quatre hommes tordent à la manière d'un linge que l'on essore (fig. dans le titre). Avec des bâtons introduits dans des noeuds coulants aux extrémités du sac ils donnent de la force à leur mouvement. Le vin est transvasé dans des jarres et les cruches bouchées. Sur la coiffe de limon un employé de la Trésorerie appose son sceau, car des scribes assistent à l'opération et tiennent les comptes, ce qui n'empêchait pas la fraude de sévir. Les Egyptiens de l'Ancien Empire consommaient plusieurs sortes de vins: du blanc, du rouge, du noir, et du vin de Basse-Egypte. 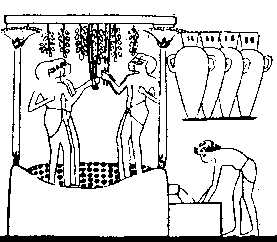 Dans le Nouvel Empire, la culture de la vigne fut étendue et certains pharaons ont constitué des vignobles royaux. On a trouvé des sceaux d'argile ayant servi d'étiquettes avec la mention: vignobles du Palais Royal. L'origine, la cave où le vin était conservé étaient mentionnées; ainsi que sa qualité et l'année où il avait été produit. Des vins bien faits, ou une bonne année, étaient distingués par les appréciations comme : bon, deux fois bon, huit fois bon, etc... 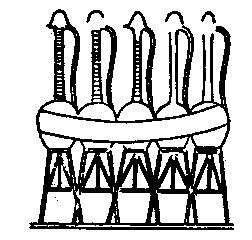 ...par des connaisseurs. Les Romains et les Grecs appréciaient certains crus du Delta. L'Antiquité nous rapporte que le maréotique était un blanc doux et léger, il aurait embrasé le coeur de Cléopâtre ; d'après Pline le selemnytique était fabriqué avec deux sortes de raisin et de la résine de pin ; le taniotique était blanc, doux et onctueux. C'était une habitude d'associer des vins de plusieurs variétés. Le mélange devait se faire au moment du repas car les chevalets supportant les cruches de mélange étaient des meubles d'apparat. L'Egypte constitue un exemple privilégié en raison de l'ancienneté de cette civilisation, et de l'abondance de documents précis et purement techniques qu'elle nous a laissé. Son étude appelle certains commentaires et en premier lieu celui de la place des boissons fermentées dans le quotidien de la vie. 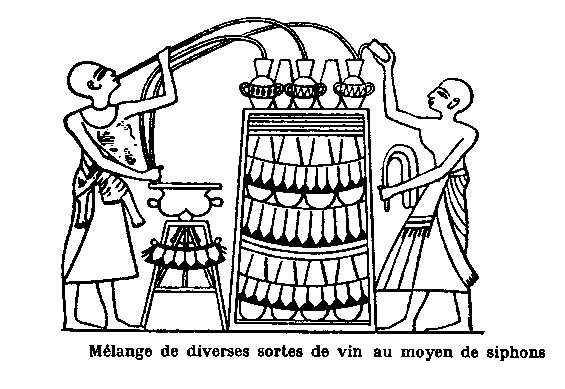 La pollution et l'hygiène des eaux... Les particularités du milieu naturel de ces régions mettent en lumière un facteur peut-être essentiel du développement de ces boissons qui est celui de l'hygiène des eaux. L'Egypte et la Mésopotamie ont vu naître des civilisations dites potamiques. Dans ces régions arides, la vie s'est développée sur les rives fertiles de fleuves venus de régions lointaines. Il y a peu de précipitations, peu ou pas de sources et pour cette raison les eaux naturelles y sont rarement potables. En Egypte, dont nous parlions, l'eau est amenée par le Nil qui fertilise le désert. Pour l'irrigation et l'usage domestique les paysans creusaient des puits à distance du fleuve et des canaux. Cette eau, loin d'avoir la pureté habituelle d'une eau de source, était très exposée à la contamination dans les concentrations humaines déjà très importantes de l'antiquité. La bilharziose, par exemple, sévissait dans l'Egypte des pharaons. Certaines figurations mettent en évidence, avec réalisme, l'émaciation du corps, caractéristique de cette maladie. Les parasites intestinaux, largement distribués par les eaux, ont beaucoup occupé les médecins de l'ancienne Egypte parce qu'ils avaient l'avantage d'être visibles (mais l'on voyaient en eux la conséquence, et non la cause, des maladies). Si nous ajoutons à ce bilan, non seulement les amibiases, le vibrion cholérique et autres salmonelloses, mais encore les eaux salines, saumâtres ou magnésiennes, on comprend que la qualité de cet approvisionnement fut une préoccupation constante des collectivités humaines. En fait, lorsque les sources existaient, les peuples anciens ont réalisés des travaux considérables de génie civil pour procéder à des adductions. Leurs exigences sur les critères de potabilité leur ont fait négliger des ressources assez proches au profit de sources beaucoup plus éloignées. Certains documents expriment bien la méfiance à l'égard des eaux naturelles. Un rituel hébreux, contemporain des civilisations dont nous parlons, nous apprend que l'eau de boisson ne devait pas être conservée dans un récipient découvert et qu'elle ne devait être consommée dans un verre teinté. Dans ces recommandations faites aux fidèles on peut voir l'opportunité de protéger l'eau des souillures et de s'assurer de la limpidité, critère non négligeable de pureté. Malgré l'absence de connaissances bactériologiques on ne peut dire que les notions d'hygiène étaient inexistantes. "La plus saine et la plus hygiénique des boissons..." En contraste avec le danger immédiat ou différé que peut présenter la consommation d'eau naturelle, rappelons que le processus fermentaire de formation d'alcool élimine les germes pathogènes et assure une sécurité bactériologique absolue. Il n'est pas surprenant que la pureté du vin à cet égard fut révélée dès les premières découvertes pasteuriennes, ce qui évidemment ne lui retire pas une nocivité toxicologique qui est d'une autre nature. Il saute aux yeux cependant qu'en une époque où la durée moyenne de la vie était moins longue, les méfaits de l'alcoolo-dépendance n'avaient pas l'occasion de se manifester d'une façon suffisamment évidente pour avoir le retentissement qu'on leur connaît de nos jours. Tant que l'hygiène des eaux n'a pu être comprise, contrôlée et assurée avec efficacité le bilan humain fut probablement favorable aux boissons alcoolisées, à ne considérer que le seul aspect microbien. Les anciens ne buvaient pas que du vin et de la bière, mais leur intérêt pour ces boissons était fondée, semble-t-il, en partie, sur un motif oublié à notre époque: la sécurité de leur consommation. Le risque morbide se présentait sans doute à l'inverse de celui que nous connaissons et les boissons non fermentées étaient à consommer avec prudence. Certes l'alcoolisme était connu, l'histoire de Noé et celle de Loth ont un contenu moral qui témoigne de l'ancienneté du côtoiement de l'homme et de l'alcool. Des lois réprimaient les ivresses mais l'alcool, agent stérilisateur et purificateur, est aussi un agent conservateur. Cette propriété est précieuse en regard des nécessités de manipulation, de stockage et de transport, conditions toujours actuelles d'un devenir économique de ces boissons sans lequel un devenir culturel n'aurait pu exister. Jusqu'à la ...pasteurisation. Il a fallu attendre de XIXème siècle de notre ère pour que l'humanité dispose d'autres moyens de conservation des liquides tels que la stérilisation par la chaleur (appertisation, pasteurisation) la pression de gaz carbonique (sodas) ou par des stabilisateurs divers. On peut cependant souligner que, de nos jours encore, seul le vin peut se conserver et se transporter en vrac sans embouteillage préalable, ce qui le laisse sans concurrence dans le domaine si important de la distribution. Dans un monde où la nocivité de l'alcool est rendue plus évidente par l'allongement de la vie humaine, nous ne devons pas oublier l'avantage que les sociétés antiques ont pu en retirer: outre l'apport nutritionnel, l'alcool, agent conservateur et purifiant, méritait à leurs yeux d'être célébré pour d'autres raisons que ses seules qualités enivrantes. Rappelons aussi que le produit en cause, qui nous est familier - l'éthanol - était ignoré. Seule était connue la fermentation, agent mystérieux d'une transformation qui donnait au breuvage ses précieuses propriétés en même temps qu'elle le rendait inflammable. Cette transformation en vin est pour la liturgie catholique le "fruit de la terre et du travail des hommes", mais elle a été célébrée bien antérieurement: "Il y a deux divinités, ô jeune homme, qui tiennent le premier rang chez les hommes. L'une est la déesse Démeter (qui, reconnaissante, donna aux hommes le grain de blé) c'est elle qui d'aliments solides nourrit les mortels. L'autre s'est placé de pair avec elle, c'est le fils de Sélémé (Dionysos). Il a trouvé un breuvage, le jus de la grappe et l'a introduit parmi les mortels..."(Euripide, Les Bacchantes). On a émis l'hypothèse que l'humanité avait opéré un choix en faveur d'une substance enivrante: la soma, breuvage sacré, à la composition inconnue, associé aux religions védiques dans le monde oriental, les boissons alcoolisées dans le monde occidental. Mais à côté du pouvoir mystérieux par lequel, il est capable d'exalter ou de terrasser l'âme humaine, l'alcool procure à l'homme un agent de purification biologique resté sans concurrence pendant des millénaires ce qui lui garantit une importance socio-économique de premier ordre. Nous remarquerons en terminant un contraste qui à pu peser sur l'appréciation morale toujours attachée à l'alcoolisme : la nocivité des eaux est un aléa de la nature indépendant de la volonté et du pouvoir de l'individu ; la nocivité des boissons fermentées est liée à l'usage qu'en fait la personne. Si quelque démon malfaisant est en accusation, il sera désormais intérieur à l'homme et non propagé sournoisement par la source où il s'abreuve. (08/03/03 - m. à j. 25/03/04). 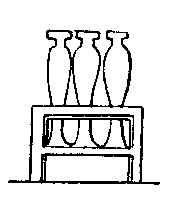 |
| Retour à l'Index |
| Site créé le 02 août-1997. - Dr J. Morenon, 8 rue des tanneurs, F-04500 RIEZ |